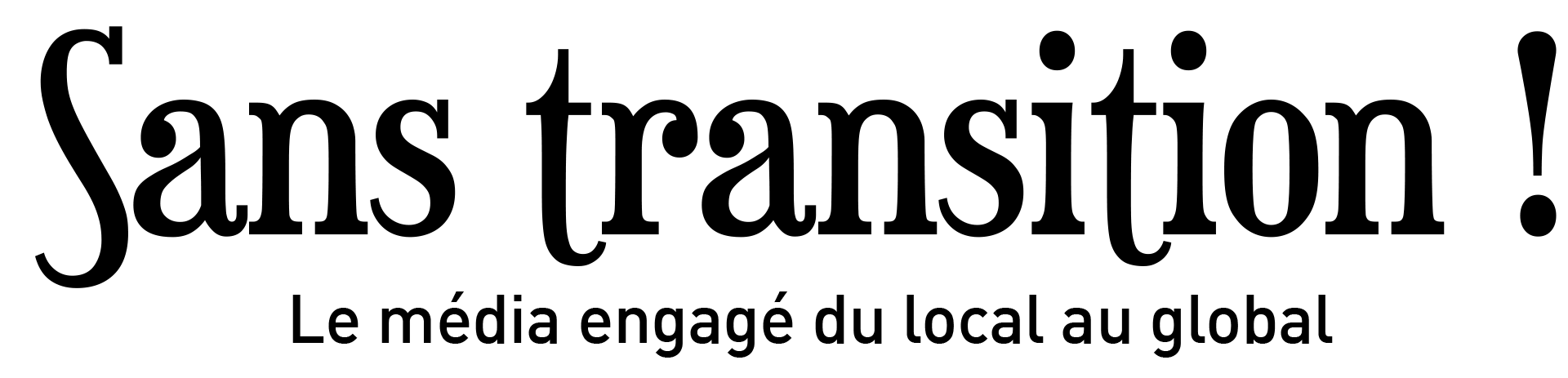Par Guillaume Bernard.
Réduire son temps de travail, seul salut pour la planète ? La question est sérieusement posée par des chercheurs qui soulignent la corrélation entre croissance économique et destruction de la planète. Et pour y parvenir, peut-on envisager un revenu universel pour sortir de la logique productiviste de nos sociétés, et ainsi, faire baisser nos émissions de CO2 ? Analyse.
Alors que les courbes de la croissance économique et des émissions de CO2 augmentent parallèlement, plusieurs chemins s’offrent à nous : renouveler l’outil de production pour le rendre moins polluant ou produire et travailler moins ?
Savez-vous quelle est la dernière fois que nos émissions mondiales de CO2 sur une année ont été plus basses que celles de l’année précédente ? Pas besoin d’aller chercher une réponse au paléolithique ou au Moyen-âge, cette date est récente : 2009. À l’époque, le monde vient de vivre deux années de crise économique majeure et les pays les plus riches affichent une croissance négative : aux États-Unis et en France le produit intérieur chute de 2,5%. Si économiquement tout va mal, il y a néanmoins une grande gagnante à la crise des subprimes : la planète. Dans les pays riches, l’émission de CO2, principale cause identifiée du changement climatique, a drastiquement baissé en 2009 : - 5,2 % en France, - 6,9 % aux États-Unis, - 8,6 % au Royaume-Uni, - % en Allemagne et jusqu’à - 11,8 % au Japon. Même si, à l’échelle mondiale, cette réduction est presque entièrement compensée par la croissance maintenue des pays émergents (Chine et Inde en tête), le total du CO2 mondial émis en 2009 est de 1,3% inférieur à celui de 2008. Ce n’est pas la première fois qu’une crise économique entraîne la réduction des émissions de CO2, explique l’Agence Internationale de l’Energie (affi liée à l’OCDE). La crise de 1929, la fi n de la seconde guerre mondiale en 1945 et les chocs pétroliers des années 1973 et 1979 sont autant de dates suivies elles aussi d’une baisse des émissions carbones. Il faut donc une crise économique, une hausse du chômage et des vies brisées pour qu’enfi n reculent nos émissions de CO2 ? Si le constat est cynique, il est pourtant historiquement exact.
« Si la durabilité écologique nécessite une baisse générale de la consommation, alors l’augmentation du temps de loisir n’est pas tant un luxe mais une urgence », Philippe Frey, chercheur
Croître sans polluer ?
Si émission de CO2 et croissance vont pair, faire de l’écologie signifi e-t-il renoncer à la croissance ? Tel était l’un des principaux enjeux de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012, dite Rio+20. Une réponse fut apportée, qui tenait en deux mots : croissance verte. Le découplage entre croissance et émission de CO2 est possible et les principaux acteurs de l’économie doivent y contribuer.
En France, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, portée par Ségolène Royal en 2015 entend inscrire nombre de mesures écologiques dans le droit. Parmi elles on trouve entre autres : la volonté de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation d'énergie en 2030, l’obligation pour les vendeurs de matériaux dans le BTP d’atteindre l’objectif de 70 % de recyclage des déchets en 2020, ou encore, l’indemnité kilométrique vélo, versée facultativement par l’employeur. Pourtant, la stratégie de la croissance verte montre aussi ses limites. L’étude Is Green Growth Possible ? publiée en avril 2019 par les économistes de l’environnement Jason Hickel et Giorgos Kallis dans la revue New Political Economy, conclut qu’elle n’est applicable que dans les pays riches et pour une durée déterminée. En effet, difficile de reproduire année après année les performances scientifiques qui permettent de réduire toujours davantage l’énergie consommée pour produire. Julien Fosse, directeur adjoint au développement durable et numérique chez France Stratégie, qui décrypte cette étude sur son blog, explique que « les modélisations effectuées par les deux chercheurs montrent que pour contenir les émissions de CO2 dans des limites compatibles avec un réchauffement planétaire inférieur à 1,5°C, des stratégies de décroissance devraient être mises en oeuvre ».
Une vision que partage Baptiste Mylondo, économiste enseignant à Sciences Po Lyon : « Les avancées technologiques nous laissaient espérer des économies d’énergie, or elles n’ont fait que développer de nouveaux comportements toujours plus polluants. En économie, c'est ce qu’on appelle l’effet rebond : aujourd’hui on sait produire une 2CV en consommant beaucoup moins d’énergie que dans les années 1950… Sauf qu’en 2020 plus personne ne veut de 2CV : on fabrique des voitures avec des moteurs plus puissants, bourrées d’électronique... Résultat : l’industrie automobile pollue toujours plus. » Or selon le GIEC, limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C nécessite une réduction des émissions de CO2 de 45 % d’ici 2030. « Au lieu de tenter de réduire le coût écologique de notre croissance, produisons et travaillons moins », conclut Baptiste Mylondo.
Gaspiller moins pour produire moins
Une étude du think tank britannique Autonomy donne d’ailleurs raison à Baptiste Mylondo. Afin de ne pas dépasser le seuil des 2°C de réchauffement climatique, la Suède devrait passer à la semaine de 12 heures, la Grande-Bretagne à la semaine de 9 heures et l’Allemagne à la semaine de 6 heures. « Si la durabilité écologique nécessite une baisse générale de la consommation, alors l’augmentation du temps de loisir n’est pas tant un luxe mais une urgence », conclut Philippe Frey, le chercheur qui a chapeauté cette étude.
Mais peut-on réduire notre temps de travail dans un monde où 10,8% de la population a faim ? C’est la question que se verra légitimement opposer toute personne soutenant l’idée d’une baisse de notre activité. Le rapport annuel sur « l’état de la sécurité alimentaire dans le monde », publié par plusieurs agences des Nations Unies, révèle qu’un peu plus de 820 millions de personnes étaient sous-alimentées en 2018. Il précise toutefois que nous produisons de la nourriture en quantité suffisante pour les 7,7 milliards de Terriens (soit l’équivalent de la population mondiale actuelle). Ce n’est donc pas le niveau de la production mais bien sa gestion qui fait défaut.
En 2019, les pertes et le gaspillage alimentaire en France représentent 10 millions de tonnes de produits par an, un total estimé à 16 milliards d’euros : « un prélèvement inutile des ressources naturelles, et des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 3% des émissions totales françaises », stipule le ministère de l’environnement. Dans cette affaire, il est inutile d’accuser les enfants capricieux qui ne voudraient pas finir leur assiette. Loin d’être un problème de comportements individuels, environ 70 % du gaspillage se fait lors des processus de production, de transformation et de distribution. « Le problème, c’est que les producteurs n’ont plus la main sur le processus de production. Si la question de la production était une question démocratique, soumise à la délibération collective, non seulement on pourrait décider de produire moins et enfin se demander à quoi sert notre travail. Reposer la question : “combien de temps et pourquoi voulons-nous travailler et produire ?”, c’est aussi cela l’écologie », soumet Didier Aubé, responsable des questions écologiques dans le syndicat Solidaires.
L'utilité sociale du travail
À l’heure où la suractivité est directement liée au réchauffement climatique, l’adage « il n’y a pas de sot métier », semble d’un autre temps. « La valeur d’un emploi n’a rien à voir avec son utilité sociale, elle dépend simplement de ce que le travailleur rapporte à l’actionnaire. Cela n’a rien d’une fatalité, c’est un choix politique », soutient Baptiste Mylondo.

La déforestation, justifi ée par la culture d’oléagineux pour l’alimentation animale ou pour des biocarburants, est responsable de plus de 10 % de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. Photo : Pixabay
C’est ce paradigme que trois chercheuses britanniques de la New Economic Foundation ont entrepris d’inverser dans une étude publiée en 2009. Elles s’y demandent quelle est la valeur sociale de certains emplois. « Pour déterminer la contribution sociale nette d’un métier, expliquent Lawlor, Kersley et Steed, il faut tenir compte de ses impacts indirects sur l’économie, l’environnement, la société. » Le journaliste Pierre Rimbert, qui commente leur étude dans Le Monde Diplomatique de mars 2010 rapporte : « leur méthode établit qu’un conseiller fiscal, dont l’art consiste à priver la collectivité du produit de l’impôt, détruit quarantesept fois plus de valeur qu’il n’en crée, contrairement à l’employée de crèche qui, par l’éducation prodiguée aux enfants et le temps libéré pour les parents, rend à la société 9,43 fois ce qu’elle perçoit en salaire. » Cette comparaison nous pousse à nous questionner : un conseiller fi nancier n’est-il pas plus utile lorsqu’il rentre chez lui s’occuper de ses enfants que lorsqu’il est « au boulot » ? Des activités absolument primordiales ne sont pas reconnues comme du travail et donc peu valorisées et pas rémunérées. Les femmes consacrent ainsi, gratuitement, 3h26 de leur « temps libre » quotidien aux tâches ménagères, contre 2 heures pour les hommes, sans que cela ne soit considéré comme du travail. « Il faut distinguer un emploi, qui est l’activité pour laquelle un employeur nous verse une rémunération suite à un contrat, du travail qui englobe toute activité productrice de valeur d’usage », explique Baptiste Panier, militant au Réseau Salariat, une association d’éducation populaire. En adoptant ce point de vu, on constate qu’une grande part du travail se fait actuellement hors de l’emploi et donc gratuitement. Reconnaître comme du travail les activités socialement utiles et réduire celles qui ne le sont pas pourrait être un premier pas vers une société où l’augmentation perpétuelle de la production ne serait plus l’alpha et l’oméga de l’organisation économique. Mais qui déciderait de l’utilité de telle ou telle activité ? Si la question reste ouverte, Baptiste Mylondo apporte néanmoins sa propre solution : « Il faut reposer la question de la décence en économie, passer de l’obsession “comment produire davantage” à : “qu’est-ce qui nous suffit ?” et y répondre collectivement ». Dans cette perspective « travail », « emploi », « richesses », sont autant de mots que l’urgence climatique nous pousse à questionner.