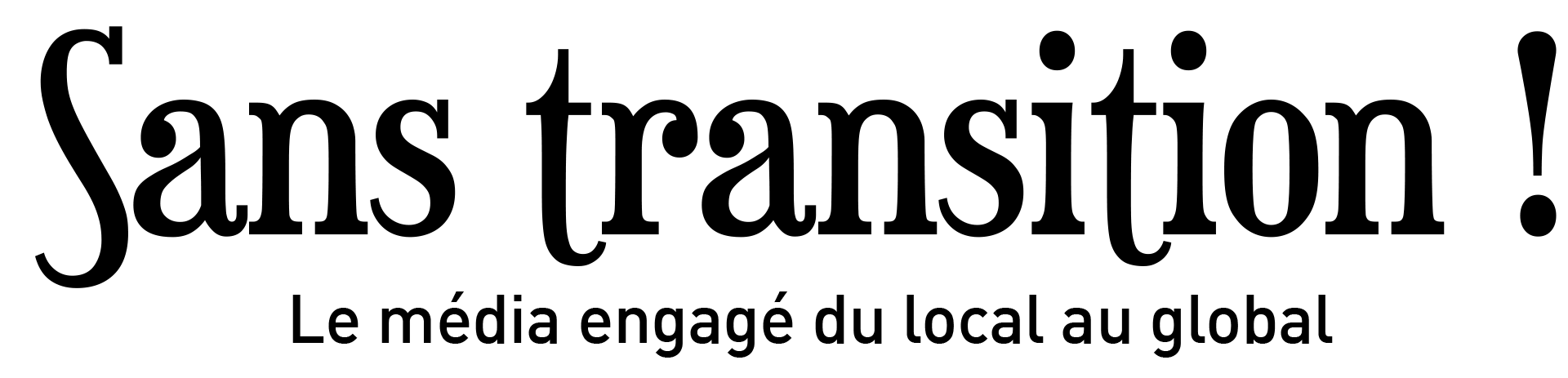Par Anna Sardin et Quentin Zinzius
Face aux risques de pénuries alimentaires, la France est-elle correctement préparée ? Pour Stéphane Linou, Pablo Servigne et Florence Denier-Pasquier, pas de doute : il nous reste du pain… sur la planche.
Pablo Servigne
Auteur de plusieurs livres sur l'effondrement et l’entraide, Pablo Servigne se définit comme un chercheur « in-terre-dépendant ». Son dernier livre, coécrit avec Gauthier Chapelle, « L'effondrement (et après) expliqué à mes enfants… et à mes parents », est sorti en septembre aux éditions du Seuil.
Stéphane Linou
Conférencier et initiateur des “défis locavores bas carbone”, Stéphane Linou est spécialiste des liens entre non-résilience alimentaire des territoires et sécurité civile. Il est devenu récemment officier sapeur-pompier volontaire dans ce domaine d'expertise.
Florence Denier-Pasquier
Juriste environnement spécialisée dans le droit de l’eau, Florence Denier-Pasquier est membre du conseil d’administration de France Nature Environnement. Elle a également siégé pendant dix ans au Conseil économique social et environnemental (CESE) pour lequel elle a notamment co-rapporté l’avis « Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires » (2020).
Cet été, la France a connu une pénurie de moutarde et cet hiver, ce sont les produits laitiers et les légumes qui risquent de manquer. Qu’est-ce que ces évènements disent de la souveraineté alimentaire de notre pays ? Et comment en est-on arrivé là ?
P. Servigne : Depuis l'après-guerre, la mondialisation a provoqué une spécialisation des régions et des pays du monde. L’objectif était clair : l'abondance et la maximisation du commerce par les avantages comparatifs ; en un mot, la globalisation. Mais le développement de ce modèle nous a rendus extrêmement dépendants des autres pays et régions du monde, d’un système alimentaire industriel, et d’une agriculture qui cherche la quantité à l’hectare coûte que coûte et non la qualité, l’efficience, ni la santé des gens et des écosystèmes. La France en est arrivée au point où elle exporte et importe des céréales pour sa consommation, ce qui est totalement absurde. Ce système alimentaire est effectivement très puissant, mais il est aussi très toxique et vulnérable. Les pollutions et les pénuries en sont des symptômes.
F. Denier-Pasquier : Ces pénuries sont d'ailleurs de véritables signaux d'alerte. L'exemple de la moutarde de Dijon est édifiant : un produit iconique du territoire s'est retrouvé mis en concurrence avec la production mondialisée, plus de 80 % de la production des graines provenant du Canada dont la baisse de production a conduit à des ruptures d’approvisionnement ! Tout cela démontre que, dans ce système, les produits circulent trop. L'unique boussole de notre système alimentaire est le profit, au détriment des équilibres alimentaires de nos assiettes et de notre propre résilience. Bien sûr, nous savons et nous pouvons produire l’essentiel de notre nourriture. Cette année nous avons par exemple à nouveau produit plus de moutarde et de tournesol sur le territoire du fait de la revalorisation des prix versés aux producteurs. Il y a un enjeu de régulation du marché des denrées alimentaires et d’un meilleur équilibre de la politique publique de l’alimentation : aujourd’hui le ministère de l’Agriculture est trop puissant et peu à l'écoute des enjeux que portent les ministères de l'Ecologie et de la Santé.
S. Linou : Ces évènements démontrent finalement que nous sommes dans une illusion de sécurité alimentaire. Depuis trop longtemps, nous avons considéré le fait de manger comme un acquis, alors que notre système alimentaire globalisé repose sur une double dépendance aux flux : l'exportation de la surproduction et l'importation de ce qui n'est plus produit sur place. Cette dépendance du système alimentaire à la globalisation appelle au plus ancien couple de risques : alimentation et sécurité. Or la légitimité du pouvoir politique repose sur sa capacité à pouvoir assurer la sécurité de ses habitants, qu'elle soit sanitaire, extérieure ou alimentaire.
Quels sont les risques majeurs qui pèsent sur ce système globalisé ?
S. Linou : Tout d’abord, comme nous venons de le mentionner, nous n’avons rien de prévu en cas de rupture d'approvisionnement. Actuellement, 70% des produits de consommation sont achetés dans les grandes surfaces qui n’ont que deux jours de stock. Il n'y a pas non plus de stocks alimentaires stratégiques d'État qui permettraient de temporiser une rupture brutale, en attendant la mise en place d'une alternative d'approvisionnement. Pire encore : le détricotage des infrastructures nourricières a été si efficace que nous pouvons aujourd'hui avoir une production alimentaire supérieure aux besoins sur un territoire mais être incapable d'en nourrir les habitants. Tout le monde n’en est pas encore conscient, mais croyez-moi : au menu des emmerdes, nous n’en sommes qu’à l’apéro !
P. Servigne : Effectivement, stocker de la nourriture pour quelques semaines ou mois, ce n’est pas un délire survivaliste, nos grands-parents le faisaient naturellement. Nous arrivons dans une époque d’incertitudes ; les événements extrêmes que nous vivons vont devenir de plus en plus violents et fréquents. Or l’agriculture est justement une science du vivant basée sur la stabilité et la prévisibilité… La littérature scientifique alertait d'ailleurs sur les risques de grandes ruptures des quatre à cinq greniers à grains du monde (« breadbasket failure »). L’Ukraine, par exemple, en faisait partie… Le climat, les événements extrêmes, les risques de guerre ou de sécheresse peuvent tous impacter ces grands greniers. Pire, avec les catastrophes globales, un nouveau risque a émergé : que les ruptures des greniers à grains surviennent en même temps ! C’est un risque majeur de catastrophe globale qui pèse sur la sécurité alimentaire mondiale, ce qui inclut bien évidemment la France.
F. Denier-Pasquier : Je pense qu'il y a aussi un sérieux problème de main-d'œuvre sur notre territoire, à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. Nous manquons déjà d'agriculteurs, d'ouvriers dans les usines agroalimentaires, de personnels dans la distribution. Ces métiers souffrent d'une très mauvaise réputation, à cause de leurs conditions de travail et des salaires peu élevés bien sûr, mais aussi d'un manque de reconnaissance. Mais avec un objectif de résilience territoriale, ces métiers sont tout bonnement indispensables.
Notre vision du système agricole serait donc au cœur du problème ?
P. Servigne : Le problème de l'agriculture industrielle est qu'elle est extrêmement dépendante des énergies fossiles et des minerais : pétrole, gaz, charbon, phosphates, etc. Il faut se sevrer rapidement de ces énergies « faciles » pour préserver la stabilité du climat et maintenir des conditions viables de production alimentaire. Sevrage rapide, mais pas brutal, sinon on risque de paralyser la totalité du système alimentaire, ce qui serait évidemment gravissime. Ce que nous avons gagné en efficacité depuis l’après-guerre, nous l’avons perdu en résilience.
F. Denier-Pasquier : Sans oublier un des autres risques à venir : celui de la gestion de l'eau. Aujourd'hui en France, 8% des terres cultivables sont irriguées par environ une exploitation sur cinq. Mais cette irrigation pèse pour 45% de la consommation d'eau française chaque année. Ce qui veut dire que, dans un contexte de réchauffement global, nous allons très vite être soumis à un important stress hydrique. De plus en plus d'exploitations vont chercher une ressource en eau déjà soumise à des restrictions : la question du partage de l’eau entre les productions vivrières et les autres productions agricoles devrait être beaucoup mieux traitée par les politiques publiques.
S. Linou : Finalement, le plus grand risque selon moi est la suffisance de croire que nous sommes plus forts que les lois de la physique. Nous nous croyons supérieurs à la Nature. Nous considérons les ressources comme gratuites et illimitées et la technologie comme salvatrice. On met des panneaux solaires dans les champs et des légumes sur les toits : cherchez l’erreur ! Ce système fonctionnait jusqu’à présent parce que nous avions des moyens énergétiques. Mais sans cette abondance, c'est non seulement le système globalisé qui est menacé mais aussi tous les systèmes locaux qui en sont dépendants.
Dans ce contexte, quels sont les changements prioritaires à apporter à ce système pour garantir une certaine résilience alimentaire ?
P. Servigne : Au niveau de la production agricole, il va falloir tout réinventer ; continuer à produire de la nourriture tout en produisant notre énergie, en régénérant les écosystèmes, et faire tout cela avec peu de pétrole et d'intrants, un climat instable, imprévisible, et des écosystèmes exsangues. Concrètement, il y aura beaucoup moins de tracteurs, de mécanisation. C’est un immense défi ! C’est ce que les adeptes de la permaculture appellent une « agriculture intensive en main-d'œuvre et en connaissances ». Sans pétrole, comme disait l’autre, il faut des idées et de l’huile de coude ! Pas d’autre solution. Une lourde tâche attend le paysan du futur. Si une transition agricole réussie se met à place en France en moins de dix ans, un quart de la population, soit 20 millions de personnes, se retrouvera possiblement impliquée dans des travaux agricoles ! Question de survie. Je crois que l’on ne se rend pas compte.
F. Denier-Pasquier : Je pense que réduire le gaspillage alimentaire à toutes les échelles serait une véritable avancée. Nous perdons chaque année l'équivalent de dix millions de tonnes de produits alimentaires, soit l'équivalent d'un repas par personne et par semaine. Ce qui veut dire que sans même changer profondément les politiques globales, nous pouvons déjà réduire considérablement nos besoins alimentaires (puisque plus nous gaspillons, plus nos besoins sont élevés pour couvrir la demande réelle) et donc augmenter notre résilience. Il va aussi falloir produire au maximum, et à proximité, un contenu rééquilibré pour nos assiettes. Aujourd'hui, les données de santé publique sont très claires : nous ne mangeons pas assez de légumineuses et trop de viande, pas assez de fibres et trop de matières grasses, notamment. Les maladies liées à une alimentation déséquilibrée constituent une véritable épidémie. Les politiques publiques doivent partir de l’équilibre alimentaire souhaitable pour repenser complètement nos circuits alimentaires. Cela ne veut pas dire que l'élevage doit disparaître, le fumier d'élevage jouant un rôle important pour la culture végétale, mais que sa part dans notre système agricole doit drastiquement diminuer.
S. Linou : Quant au niveau politique, les outils existent déjà, il n'y a rien à inventer. En revanche, il va falloir prendre en main ces outils rapidement. Par exemple, au niveau local, le plan communal de sauvegarde qui décline les risques majeurs peut encadrer le risque de rupture d’approvisionnement alimentaire. Et nous avons de la chance : la loi Matras, promulgée en novembre 2021, indique qu'à partir du moment où une commune a un plan communal de sauvegarde, l’intercommunalité à laquelle elle appartient doit aussi en mettre en place un au niveau intercommunal. Or l'échelle intercommunale correspond au périmètre du projet alimentaire territorial (PAT). Et si les PAT ne sont pas encore obligatoires ni supérieurs aux documents d’urbanisme (plan climat-air-énergie territorial et plan local d'urbanisme intercommunal), ils partagent le même périmètre. Ainsi, d’une idée de risque, nous pouvons passer à une planification sans laquelle il est impossible d’augmenter notre résilience alimentaire.
L'échelle locale serait donc la plus adaptée à la mise en place de la résilience ?
Florence Denier-Pasquier : Tout dépend de la façon dont sont imaginées les politiques locales. Pour reprendre l'exemple des PAT, si l'objectif est simplement de distribuer localement les productions du territoire, alors ce n'est pas une ambition suffisante. Il y aussi un problème de représentativité des consommateurs et des acteurs de la santé publique dans les réunions de concertation ; souvent face à une agriculture conventionnelle sur-représentée et peu motivée à faire évoluer l’organisation actuelle en filières de productions végétales ou animales. En revanche, l'échelle locale permet d'imaginer des contrats à l'échelle du territoire, entre producteurs, transformateurs et collectivités, sur plusieurs années. Cela va non seulement permettre aux producteurs d'adapter leurs productions aux besoins locaux en s'assurant un revenu et de la visibilité, mais cela limitera aussi grandement le gaspillage (d'énergie dans le transport, et alimentaire) tout en resserrant les liens avec les consommateurs.
S.Linou : Il n'y a pas une seule et unique échelle à conserver. La résilience, c'est une hybridation des échelles. Aujourd'hui, ce qui fait qu'un territoire n'est pas résilient, c'est qu'il dépend du système global à très court terme, et de l'énergie pour son approvisionnement. Il faut donc recréer localement un « filet de sécurité alimentaire territorialisé », pour être capable de gérer une rupture brutale. Cela passe par la reconstitution d'un « microbiote territorial », composé de 5 acteurs : producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et collectivités. Mais aussi par des liens avec les autres territoires.
P.Servigne : Le local nous protège des chocs globaux, mais il ne faut pas oublier que le commerce global nous rend aussi résilient face aux chocs locaux : si une sécheresse survient par exemple sur un territoire localisé, le système global peut subvenir aux besoins du territoire touché. Je suis aussi d'avis qu'il faut prendre du recul sur la situation. L'alimentation, ce n'est pas qu'un problème local, ou franco-français, c'est aussi un problème régional, biorégional, européen, international… Il y a beaucoup de verrous institutionnels, juridiques et idéologiques à faire sauter, par exemple sur la PAC (politique agricole commune) puisqu’elle instaure une compétition alimentaire au niveau européen, qu'elle empêche de jeunes agriculteurs de s'installer, qu'elle privilégie les exploitations industrielles, etc. Des déblocages au niveau plus global peuvent affecter les échelles locales, il faut penser systémique quand on pense transition.
Alors que les politiques peinent à s’emparer de cette question, agriculteurs et consommateurs peuvent-ils, à eux seuls, faire pencher la balance ?
P. Servigne : C'est effectivement un grand levier. Vous avez beau produire des beaux légumes, si personne ne veut manger de légumes, vous aurez l’air malin ! Il y a donc plusieurs questions à se poser démocratiquement si on veut anticiper, si on veut faire une transition avant que les chocs et la faim nous fassent changer dans l’urgence. Qu’est-ce que je veux vraiment manger ? Est-ce que je peux sérieusement continuer à manger n’importe quoi, n’importe quand ? Est-il nécessaire de manger autant ? Doit-on continuer à gaspiller la moitié de la production agricole mondiale ? Les réponses à ces questions sont des choix intimes mais aussi politiques.
F. Denier-Pasquier : Avant de vouloir faire pencher la balance, je pense qu'il va falloir apprendre à nous connaître. Aujourd'hui, les liens entre producteurs et consommateurs sont très faibles car rompus en permanence par la transformation agroalimentaire. Les produits ultra transformés, trop gras, trop sucrés ont par ailleurs des effets délétères sur la santé. En réapprenant à se nourrir de produits dit « bruts » ou moins transformés, à les cuisiner, nous pouvons nous passer de ces gros pôles de transformation et ainsi recréer des liens directs, en circuit court, avec les producteurs et de petites unités de transformation.
S. Linou : L’alimentation est l’un des meilleurs outils pédagogiques, non seulement auprès des collectivités mais aussi auprès des plus jeunes. Comme l'a expliqué Pablo, il y a un énorme enjeu autour de la formation des futurs agriculteurs et des futurs consommateurs. L'éducation aux risques et à la production de nourriture est, à mes yeux, aussi importante que lire, écrire, compter. En intégrant dans les programmes scolaires l'alimentation et le jardinage, nous donnerons aux futurs citoyens des clés indispensables pour comprendre le monde et assurer leur résilience.