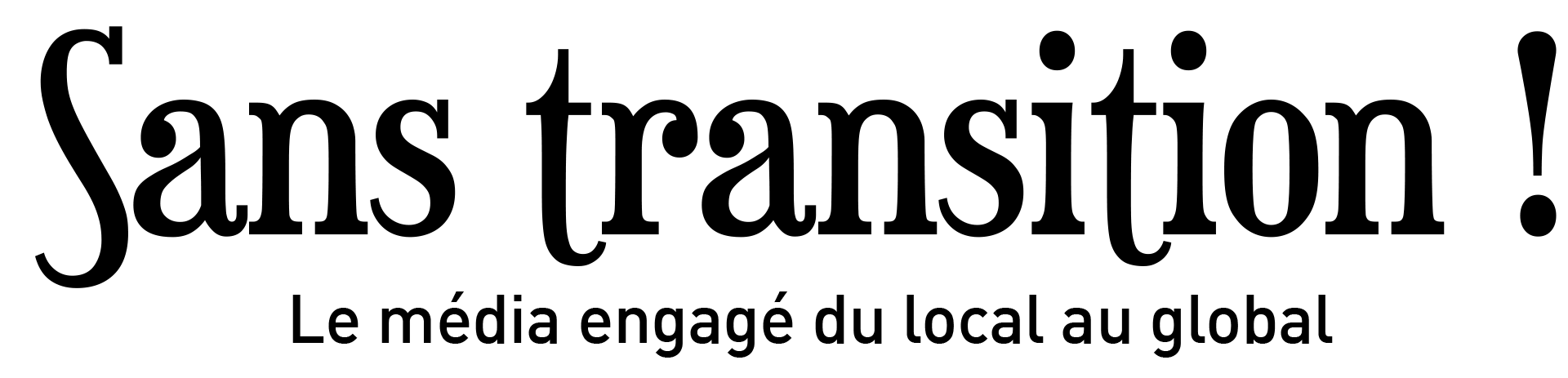Par François Delotte
Sus à l’obsolescence programmée et à la surconsommation des ressources ! Les low-tech — technologies simples, solides et sobres en énergie — proposent de répondre à une multitude de nos besoins de base, tout en réduisant nos impacts environnementaux. Plus que des objets, une véritable culture.
Méthaniseur pour produire son propre gaz avec ses déchets organiques, eau de pluie rendue potable grâce à un filtre à sable et charbon, chauffage solaire et poêle à bois ultra-performant. Le tout autoconçu. La tiny-house réalisée début 2019 par le Low-Tech Lab est un véritable condensé de low-tech, pour « basse technologie ». « Nous voulons en faire un démonstrateur des solutions low-tech. Que tout le monde puisse l’essayer. La maison ira à la rencontre de son public. Nous la mettrons à la disposition d’associations. L’idée : que tout le monde copie ses équipements et s’approprie ce qui l’intéresse ! », s’enthousiasme Clément Chabot. Il supervise la construction de la maison avec son compère, Pierre-Alain Lévêque. Tous deux sont membres de l’équipe du Low-Tech Lab, projet porté par l’association Gold of Bengal et hébergé à Concarneau (29) par le fonds de dotation Explore, du navigateur Roland Jourdain. Ce laboratoire des technologies simples, mais efficaces, s’est fixé un objectif : « Trouver des solutions accessibles au plus grand nombre pour réduire l’empreinte écologique de nos modes de vie », expose Clément Chabot. Le Low-Tech Lab, c’est aussi une plateforme web qui recense des « low-tech » testées et approuvées. On y trouvera par exemple des tutoriels détaillés pour concevoir un volet climatiseur composé de bouteilles de plastique, un chauffe-eau à bois, un séchoir solaire pour fruits et légumes et même les plans d’une petite centrale hydroélectrique permettant de produire 1 à 3 kW d’électricité.
Reprendre le contrôle des machines
Low-Tech Lab s’inscrit dans le développement de la « culture » low-tech que promeuvent et expérimentent depuis quelques années citoyens-bricoleurs, collectifs, associations et même chercheurs. Mais il serait erroné de définir ce mouvement comme une simple opposition de principe au « high-tech » et au numérique. « Il est de toute manière difficile de se passer des high-tech, notamment dans un secteur comme la santé. Il ne s’agit pas de tout débrancher et de vivre dans une grotte », estime l’ingénieur Philippe Bihouix, auteur d’un livre de référence sur le sujet, L’ère des Low-Tech (Le Seuil – 2014). Il poursuit : « Des entreprises souhaitent vendre à tout prix des objets connectés qui envahissent notre quotidien. Nous n’en n’avons pas besoin. Nous pouvons jouir d’un niveau de confort satisfaisant, sans pour autant enrichir notre environnement de technologies. Les low-tech nous alertent sur le fait que la technologie ne peut pas résoudre tous nos problèmes. »
« Le low-tech consiste à faire mieux avec moins »
Cette dernière nous en poserait même souvent de nouveaux. C’est le point de vue du sociologue Alain Gras, professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, fondateur du Centre d’études des techniques des connaissances et des pratiques (CETCOPRA). Lorsque nous l’avons au téléphone, l’homme redoute de devoir remplacer son volet roulant à fonctionnement manuel par un volet électrique. « Je ne pourrais pas le réparer seul », déplore-t-il. C’est précisément le sujet du prochain livre que prépare l’intellectuel sur la place prépondérante qu’a pris l’électricité dans notre quotidien. « Les appareils électriques ont envahi notre quotidien. En particulier nos cuisines. C’est un problème, car une grande majorité de l’électricité produite dans le monde l’est avec des énergies fossiles, notamment du charbon ou du gaz. En France, elle l’est surtout grâce au nucléaire, ce qui pose d’autres questions que celles des seules émissions de gaz à effet de serre. » Le chercheur prend un exemple précis : celui de la machine à café expresso à capsules. « En plus de consommer de l’électricité, elle comporte un menu, comme de nombreux appareils aujourd’hui. Le rapport à la machine est médiatisé par le numérique. On ne comprend pas comment elle fonctionne. On perd le contrôle sur ce type d’appareils qui, par ailleurs, ne sont souvent pas réparables », constate-t-il. « Par ailleurs, cela nous oblige à acheter des capsules en aluminium. Il faut 10 tonnes de charbon pour produire une tonne de ce métal », précise l’universitaire.
Lire aussi : Un tour du monde low-tech
Obsolescence programmée, terres et métaux rares présents dans les appareils numériques et connectés difficilement recyclables, dépenses énergétiques induites par la multiplication des équipements électriques : tout cela pousse Alain Gras à défendre l’utilisation de « technologies simples à comprendre, que l’on maîtrise cognitivement ». Des objets dont on peut changer les pièces. Que l’on n’est pas forcé de remplacer. Et que l’on peut même fabriquer soi-même, avec un minimum de savoir technique et de temps.
Des connaissances partagées
« Le low-tech consiste à faire mieux avec moins. Cette philosophie s’applique à de nombreux domaines : la cuisine, l’habitat, la mobilité, la production d’énergie », défend Clément Chabot, du Low-tech lab. Une philosophie qui se partage. Car qui dit simplicité dit facilité de transmission. Cette transmission, le réseau Tripalium en a fait son objet principal. Créé il y a dix ans, il propose dans toute la France des ateliers de réalisation d’éoliennes « Piggott », du nom de son inventeur. « Hugh Piggott est un Ecossais qui a conçu un modèle d’éolienne autoconstruite, facilement réalisable et robuste », indique Aurélie Guibert, membre de Tripalium et organisatrice de formations en Rhône-Alpes. « Les stages réunissent 10 à 15 personnes. Avec du cuivre, des aimants, du bois, du métal et de la résine, on fabrique ensemble une éolienne opérationnelle, en général en une semaine », indique cette ingénieure de formation. « La réalisation d’une éolienne Piggott coûte entre 2000 et 7000 euros, selon les modèles. C’est bien moins cher qu’une éolienne industrielle », note Aurélie Guibert. L’intérêt est « aussi de comprendre, de se réapproprier le savoir. La personne qui a participé à la réalisation de l’appareil saura comment il fonctionne, il pourra s’occuper de sa maintenance, effectuer des réparations ». Les personnes ayant assisté aux stages peuvent parfois elles-mêmes devenir formatrices et transmettre ensuite leur savoir. Il s’agit aussi d’acquérir des techniques pouvant servir à réaliser d’autres types d’objets. « L’éolienne est un prétexte. On apprend à utiliser des outils pour le bois, à concevoir des moules, à souder... Chaque stagiaire apporte ses compétences », commente Aurélie Guibert.
Lire l'interview de Philippe Bihouix : "Les low-tech sont nécessaires pour réussir la transition"
Et c’est aussi l’un des apports des low-tech : la convivialité. C’est ce que souligne le géographe Mathieu Durand, maître de conférence en Aménagement du territoire à l’Université du Mans. Ce chercheur travaille notamment sur l’apport de ces technologies au sein des services urbains. Ce scientifique prend l’exemple du compostage, une des techniques low-tech de traitement des déchets parmi les plus répandues. « Pour mettre en place un composteur à l’échelle d’un quartier ou d’un immeuble, on a besoin de coopération entre les habitants. Alors que si l’on envoie ses déchets à l’incinérateur, nous n’avons pas besoin de connaître nos voisins. L’évaluation d’une telle initiative peut aussi se faire autour de la reconstitution de liens sociaux », assure-t-il. Basse technologie, mais également hautes valeurs humaines !
Plus d’infos : lowtechlab.org/wiki/Accueil