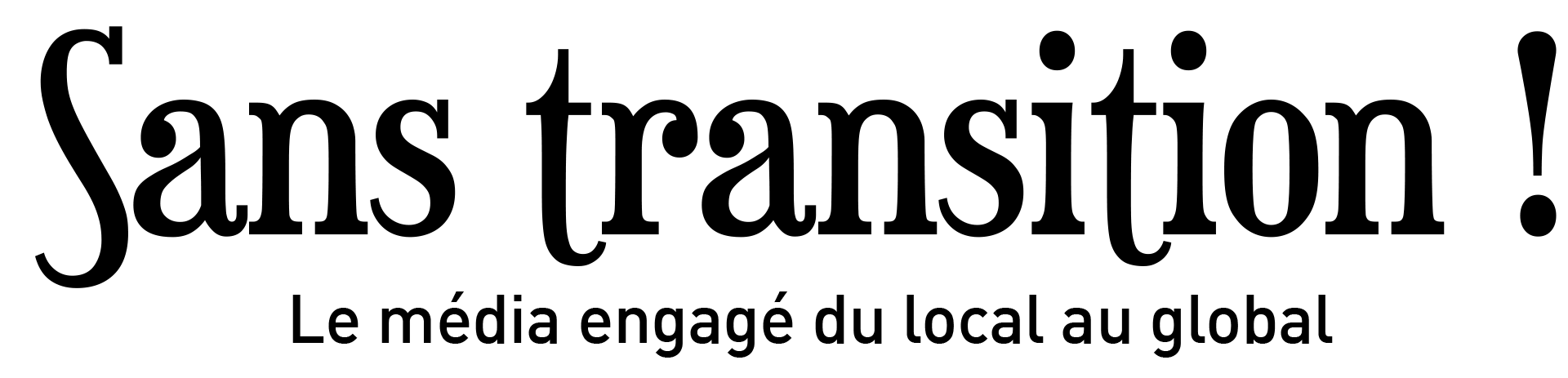VERS UNE AQUACULTURE respectueuse de l’environnement ?
Par François Delotte
La récente enquête de 60 Millions de consommateurs sur le saumon bio, plus contaminé aux métaux lourds que le saumon conventionnel, a jeté le trouble dans la filière piscicole. Pourtant, des solutions existent pour produire des poissons d’élevage sains, moins dépendants des ressources halieutiques et moins impactants pour l’environnement. Mais préserver les stocks de poissons sauvages passe aussi par le changement de nos habitudes de consommation.
L’enquête a fait des vagues dans le milieu de la pisciculture européenne. Des tests effectués par l’association 60 Millions de consommateurs sur dix pavés de saumon frais révèlent, en décembre 2016, que le saumon frais bio est plus contaminé en métaux lourds (mercure et arsenic) que le saumon d’élevage conventionnel. Contamination qui reste cependant bien en deçà des taux limites exigés par la réglementation. Et qui s’explique par les critères du cahier des charges du bio. Celui-ci impose que les poissons soient nourris avec au minimum 30 % d’ingrédients végétaux issus de l’agriculture biologique. L’autre part de l’alimentation – essentiellement des apports en protéines – est composée de farines ou huiles de poissons issus de la pêche. Des informations qui ont pu dissuader certains consommateurs d’acheter bio. Ou qui pourraient en inciter à continuer à acheter des poissons sauvages. Alors que ces derniers, plus exposés, présenteraient davantage de risques d’être contaminés. « Nous sommes en train de payer la contamination de l’environnement qui, après avoir d’abord touché les milieux terrestres, concerne désormais les océans. De fait, les organismes dont se nourrissent les poissons sont impactés. L’avantage de l’aquaculture, c’est justement de maîtriser la qualité de l’alimentation des animaux », défend Marine Levadoux, directrice du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (CIPA), instance qui réunit les acteurs de la pisciculture d’eau douce (essentiellement truite) et marine française.
Des impacts environnementaux

Avec moins de 5000 tonnes de poissons produites par an, la filière piscicole marine française reste modeste. Ici, un élevage du sud de la France. ©CIPA
Par ailleurs, les stocks de poissons sauvages ne cessent de subir la pression de la surpêche. « 90 % des espèces connues dans le monde sont surexploitées ou exploitées pleinement. Bien que des mesures, comme les quotas sur le thon rouge en Méditerranée, aient permis d’améliorer certains points, la lutte contre la surpêche reste un enjeu indéniable », rappelle Sélim Azzi, chargé de programme pêche et aquaculture durable pour le WWF France.
Parallèlement, si en France l’aquaculture représente à peine 2 % de la production aquatique consommée dans le pays (chiffres CIPA), celle-ci est en forte hausse au niveau mondial. « Avec une augmentation de la production située entre 6 et 8 % par an, c’est la filière animale qui se développe le plus à l’échelle de la planète », témoigne Laurent Labbé, directeur de la pisciculture expérimentale de l’Inra à Sizun (29). La production de ressources issues de l’aquaculture est même supérieure à celle la pêche (93,4 millions de tonnes pour la pêche contre 167,2 millions de tonnes pour l’aquaculture en 2014, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO). Dans cet ensemble, la Chine représente « 70 % de la production mondiale de poissons d’élevage, de coquillages ou d’algues », indique Marc Vandeputte, responsable de la coordination des recherches piscicoles à l’Inra.
Une production internationale, souvent intensive, qui n’est pas sans conséquence. « Lorsqu’il y a une trop forte concentration de poissons dans les cages, cela peut avoir des impacts négatifs sur l’environnement », explique Marc Vandeputte. Cela entraîne un phénomène d’eutrophisation : « le manque d’oxygène et le trop grand apport de déjections provoquent une dégradation des milieux », poursuit l’ingénieur d’études. « Ce problème concerne surtout des pays asiatiques où la réglementation est moins contraignante qu’en Europe », poursuit le chercheur. Néanmoins, des études sont actuellement menées pour valoriser les effluents issus des poissons. Comme les utiliser en tant qu’engrais pour des productions agricoles. Ou étudier la possibilité de se servir des déjections des poissons pour faire pousser des légumes en aquaponie, comme l’expérimente la pisciculture de Sizun (cf. initiatives).
Les travaux scientifiques se penchent aussi sur la nutrition et la sélection génétique des poissons. « Nous sélectionnons, par la reproduction, des animaux capables de transformer les aliments », précise Laurent Labbé. En incorporant huile de lin ou de colza dans leur régime, les chercheurs tentent de rendre la nourriture des poissons encore plus assimilable. De facto, moins génératrice de déchets.
Un aspect sanitaire est aussi pointé du doigt par les ONG, notamment dans les élevages intensifs. La production conventionnelle, en particulier de saumon, est souvent désapprouvée pour sa consommation d’antibiotiques et de pesticides pour traiter des parasites tels que le « pou du saumon ». Un petit animal qui consomme mucus, peau et sang des poissons en s’accrochant aux poissons. Le problème est de taille, notamment dans les pays scandinaves et dans les élevages écossais, puisque le pou est de plus en plus résistant aux traitements. Traitements par ailleurs polluants pour l’environnement. Des alternatives aux produits chimiques commencent à se développer. Comme « la confection de cages en métal et non plus en filet pour éviter que les poux s’y accrochent, élever plus longtemps les poissons en circuit fermé à terre. Ou encore mettre dans les cages des poissons nettoyeurs. Ces derniers se nourrissent des parasites », cite Marc Vandeputte. Mais l’une des solutions est aussi d’éviter la trop grande densité de saumon par cage pour limiter la prolifération des poux.
Autre problème soulevé par la pisciculture : le fait que des individus génétiquement modifiés, comme il peut en être produit depuis peu au Canada (saumon), puissent s’échapper des cages. Et se reproduire ensuite avec des individus sauvages, mêlant leur identité génétique aux autres poissons. « 5 tonnes de saumons transgéniques ont été produites récemment au Canada. On ne sait pas ce qu’il se passerait si des poissons s’échappaient. Ils auraient sans doute du mal à survivre dans le milieu naturel. Mais personne n’a envie que cela survienne », confie Marc Vandeputte.
Des poissons nourris aux insectes
Mais la principale question que pose le développement de l’aquaculture est celle de l’alimentation des poissons. Car parmi les espèces prisées par les consommateurs, notamment européens et français, figurent en bonne place des poissons carnassiers se nourrissant eux-mêmes de poissons. Parmi eux, bar (ou loup), dorade, truite et bien sûr saumon peuvent provenir d’élevages. Ces animaux sont en partie nourris par de la farine et des huiles de poissons issus de la pêche. L’ONG Bloom, qui lutte contre la surpêche, estime que 20 % des captures dans le monde sont aujourd’hui destinées à l’aquaculture. Le plus souvent, les poissons d’élevage sont nourris par des produits issus de la petite pêche côtière (ou minotière), qui capture des poissons peu ou pas consommés par les populations. Cependant, ce stock n’est pas inépuisable. « Nous faisons face à des problèmes de limitation de la ressource car la pêche minotière est soumise à des quotas. Dans un même temps, la demande liée à l’aquaculture augmente. On ne peut donc pas pêcher davantage ! », alerte Laurent Labbé. La filière a fait néanmoins de gros progrès en la matière. « Il faut désormais un kg de poisson pour produire... un kg de poisson ! », témoigne Emmanuel Delcroix, un des deux pisciculteurs à élever du saumon en France. « Il y a 10 ou 20 ans, il fallait près de 7 kg en moyenne pour obtenir un kg de poisson d’élevage », met en balance Sélim Azzi, du WWF France.

Des chercheurs tentent de substituer le poisson par de la farine d’insectes dans l’alimentation des espèces piscicoles carnivores. © Luk/ Wikimedia Commons
Le travail des chercheurs n’est pas pour rien dans ces progrès. L’Inra, avec la pisciculture de Sizun, a ainsi investi dans le projet NINAqua, qui teste de nouveaux aliments destinés aux poissons d’élevage. Les chercheurs travaillent notamment avec des truites fario et arc-en-ciel, espèces qui s’alimentent naturellement de petits poissons. « Il est aujourd’hui possible de nourrir des truites avec une farine composée de moins de 5 % de farine de poissons », affirme Marc Vandeputte. Les protéines sont apportées par des végétaux comme des pois ou du lupin. Dans un même temps, la sélection génétique par reproduction a donné le jour à des poissons qui assimilent de mieux en mieux l’alimentation végétale. Autre application prometteuse : l’incorporation, autorisée en France depuis juillet dernier, de farines d’insectes dans l’alimentation des truites. Le but est de les substituer aux farines de poissons. Là encore pour fournir des protéines aux salmonidés. Des oméga 3, très bénéfiques pour l’organisme, peuvent être apportés par l’adjonction d’algues marines ou de spiruline. Ces évolutions demeurent encore expérimentales. Mais prometteuses, de l’avis des chercheurs. Il convient tout de même de rester prudent car remplacer les protéines animales par des protéines végétales pourraient poser d’’autres problématiques. « Le poisson transforme mieux les protéines que les vaches ou les cochons », indique Philippe Riera, président du groupe Gloria Maris, leader de l’’aquaculture marine en France. « Pour obtenir 1 kg de bar il nous faut 2 kg de poissons sauvages. Pour moi, le problème concerne davantage les végétaux et la façon dont ils sont produits. Si on déforeste au Brésil pour faire du soja, cela pose question », affirme-t-il.
Une filière française encore modeste
Des exemples dont devraient pouvoir s’inspirer la filière aquacole hexagonale. En France, « la production représente à peine 2 % du secteur aquatique (donc pêche comprise) », indique Marine Levadoux, directrice du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (CIPA). Les français sont pourtant friands de poisson. « Ils en consomment 24 kg par an et par habitant, contre environ 20 kg en moyenne dans le monde. ». Mais « 85 % des produits aquatiques consommés en France sont importés », poursuit-elle. Le pays élève bar (loup), dorade, turbo, maigre, sole ou saumon. Et surtout la truite, en eau douce (90 % de la production soit près de 39 000 tonnes produites en 2016).
En mer, à peine plus d’une vingtaine d’élevages se partagent le marché. Ce qui représente 4 821 tonnes de poissons en 2016 (chiffres CIPA). Contre, environ 1,3 million de tonnes par an pour la Norvège. Toujours selon le CIPA, ces exploitations ne représentent que 15 hectares de surfaces occupées (dont 5 hectares en mer). Le bio (essentiellement bar, dorade et truite) n’affiche qu’ une modeste production de 3 000 tonnes (dont 500 pour la dorade) par an.
La filière reste modeste. Les professionnels évoquent souvent des lourdeurs administratives pour monter ou reprendre une exploitation. « Nous avons la chance d’avoir en France une réglementation qui permet d’apporter des garanties environnementales. Et les exploitants sont tenus de fournir une étude d’impact en cas d’agrandissement ou de création d’installations », indique Marine Levadoux. « Mais le secteur est de petite échelle et pas forcement très connu, même par les personnes qui instruisent les dossiers. Les délais d’instruction sont long (jusqu’à cinq ans) et ne sont pas toujours compatibles avec ceux des financeurs », continue la directrice du CIPA.
Pourtant l’aquaculture française possède un savoir-faire indéniable. Comme en témoigne l’expérience du groupe Gloria Maris, qui possède six sites aquacole en France (Corse, Bretagne, Haut de France, Noirmoutier) et un en Sardaigne. L’entreprise, qui élève bar, turbot, maigre et dorade, a développé deux démarches Label rouge en Corse et à Noirmoutier (cf encadré). « La France a un potentiel important. Mais malheureusement, les banques françaises ont préférés développer l’aquaculture dans des pays comme la Grèce ou la Turquie », assure Philippe Riera, président de Gloria Maris. « Lorsqu’on vend 2000 tonnes de poissons par an, le numéro 1 grec en vend 10 000 », poursuit-il.
Dans ce contexte, certains suggèrent de revaloriser les qualités gustatives et nutritionnelles des poissons d’eau douce d’étang. C’est le cas de Marc Vandeputte : « Un poisson comme la carpe n’a pas bonne réputation dans un pays comme la France. Mais il est consommé en Europe de l’Est ou en Asie, souvent sous forme de filets. Il serait possible de nourrir des carpes avec du phytoplancton – qui se développe avec la lumière solaire – et avec des céréales bio. Céréales qui pousseraient avec les effluents de l’élevage », avance-t-il. « On ne discuterait pas du caractère "bio" ou non du poisson, mais cela demande de changer nos habitudes culturelles vis-à-vis de la production en étang », confie-t-il.
D’autres, comme Sélim Azzi du WWF, indiquent qu’il convient d’abord de « réduire notre consommation de protéines animales et notamment de poisson, pour lutter contre les effets de la surpêche ». Mais aussi de consommer davantage d’espèces sous-valorisées, dont les stocks sont moins pressurisés. C’est le cas pour « le tacot, le chinchard ou le mulet ». Le développement d’une aquaculture, même raisonnée, ne sera pas la réponse unique au développement de la consommation de poissons. Du moins, si l’on désire continuer d’en consommer, tout en préservant notre santé et celle des océans !
Plus d’infos : www6.rennes.inra.fr/peima/LA-PEIMA
QUELQUES INITIATIVES LOCALES
SIZUN (29) : DES TRUITES FONT POUSSER DES SALADES

© PEIMA
La pisciculture expérimentale de l’Inra, à Sizun, dans le Finistère, est à la pointe de l’innovation. « L’enjeu de la filière piscicole est d’arriver à concilier modèle économique viable, création d’emplois en milieu rural et préservation de l’environnement », indique Laurent Labbé, directeur de la structure. Concernant le volet environnemental, chercheurs et ingénieurs travaillent notamment sur la qualité de l’eau des élevages de truites. « Nous réutilisons l’eau via des systèmes de circuits fermés et nous valorisons les effluents », précise-t-il. Selon les principes de l’aquaponie (technique agronomique qui consiste à faire pousser des plantes avec les déjections de poissons), les boues sont compostées pour faire pousser des légumes, notamment des salades. « Les truites ne consomment que peu de phosphore et d’azote présents dans leurs aliments. Ces substances se retrouvent dans leurs déjections. Ce qui constitue un engrais de qualité », explique le directeur. Tout est bon dans le poisson !
Plus d'infos : www6.rennes.inra.fr/peima/LA-PEIMA
DES MULETS NOURRIS DE PAIN RÉCUPÉRÉ

© CPIE Bassin de Thau
Produire des poissons tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Telle est la (bonne) idée du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) du bassin de Thau (34), près de Sète. La structure a lancé une expérimentation en 2015. Objectif : nourrir des mulets (ou muges), poissons injustement mésestimés des consommateurs, avec du pain récupéré dans des boulangeries et des restaurants collectifs du territoire. En association avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), une entreprise piscicole (Les poissons du soleil, basée à Ballaruc-Les-Bains – 34) et le lycée de la mer de Sète, le CPIE coordonne l’élevage expérimental de plus de 500 poissons. Une première phase de grossissement s’est terminée en juin dernier. Et c’est un succès ! « Nous avons substitué la farine de maïs au pain. Les poissons grandissent convenablement. De façon à atteindre des tailles satisfaisantes pour la commercialisation », témoigne Lucie Tiollier, chargée de suivre le projet. « Ce poisson est très présent sur nos côtes. Il n’a pas besoin de beaucoup de protéines et possède de bonnes qualités nutritionnelles et gustatives. Le but est aussi de valoriser cette espèce », indique Lucie Tiollier. Une deuxième phase du projet, prévue pour 2018, sera d’introduire des algues dans le régime alimentaire, pour apporter des protéines aux poissons et contribuer aussi à filtrer l’eau.
Plus d'infos : www.cpiebassindethau.fr
LE LOUP BIO MARSEILLAIS

© Provence Aquaculture
Ils ne sont que trois pisciculteurs, en France, à produire du bar (ou loup) bio. Provence Aquaculture est l’un deux. Installée à Marseille, en bordure des Îles du Frioul depuis 1989, l’exploitation est pionnière en la matière. Celle-ci a été reprise il y a cinq ans par Aurélien Bergeron et Fanny Stabholz. Les deux collègues poursuivent l’oeuvre du fondateur, Emmanuel Briquet, en abandonnant cependant l’élevage de la dorade pour se concentrer uniquement sur le bar. Situé aux abords du coeur du parc national des calanques, l’élevage de 2,2 hectares occupe un domaine public. Il se doit d’être respectueux de l’environnement. Ce que lui permet la certification bio. « Le taux de protéines obligatoire est de 42 % et celles-ci doivent être d’origine marine. Ce sont des farines de poissons labellisés "Friend of the sea", ce qui garantit qu’elles ne sont pas composées d’espèces en voie de disparition », explique Aurélien Bergeron. « Le reste de l’alimentation est constitué de végétaux sans OGM », poursuit-il. La production de 60 tonnes par an reste modeste. Ce loup marseillais est apprécié des bonnes tables locales. Il se vend 11 à 12 euros le kg. « C’est assez cher », avoue Aurélien Bergeron. Mais la qualité a toujours un prix.
Plus d'infos : www.provaqua.com
QUID DES LABELS ?
Encore peu de « labels »* garantissent de bonnes pratiques aquacoles (préservation de l’environnement, conditions de travail). Le plus connu est l’ASC (Aquaculture Stewardship Council), un équivalent du MSC (Marine Stewardship Council). Il a été fondé en 2010 par le WWF et l’IDH (initiative néerlandaise pour le commerce durable). Ce dernier interdit les poissons élevés dans des espaces protégés et les espèces génétiquement modifiées. La qualité des eaux et le traitement des déchets doivent être contrôlés. Mais ce signe de qualité autorise l’utilisation d’additifs (notamment pour colorer le saumon). Concernant les conditions de travail des employés, ASC se réfère essentiellement aux conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT - interdiction du travail forcé, liberté syndicale, salaire minimum, interdiction du travail des enfants…). « En tant qu’ONG, nous accompagnons les démarches d’Aquaculture Improvement Projects (AIP). Ce sont des actions d’amélioration des pêcheries d’un point de vue social et environnemental », explique Sélim Azzi, chargé de programme pêche et aquaculture durable pour le WWF France. « Une ONG peut être partie prenante avec des acteurs de l’industrie ou de la grande distribution. Nous faisons des états des lieux techniques et nous travaillons à l’amélioration des pratiques », poursuit-il. Une démarche d’AIP peut déboucher sur une procédure de labellisation ASC.
Des garanties « privées »
Bloom, principale ONG engagée contre la surpêche, est assez critique sur les « labels ». « Nous n’avons pas une confiance aveugle, notamment pour ceux créés par le privé », indique Frédérique Le Manach, directeur scientifique pour Bloom. Tout en assurant que les certifications « Agriculture biologique » garantissent d’ores et déjà « une qualité de l’eau et la non utilisation d’OGM ». En France, la Charte Qualité Aquaculture de nos Régions a été mise en place sous l’égide du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (Cipa). Traçabilité, bien-être des poissons, fraîcheur et suivi sanitaire font partie des points abordés. Mais le seul véritable label portant sur la qualité d’élevage et gustative est le fameux Label rouge. En France, il concerne le saumon, le maigre, la truite et le turbot. « Nos poissons issus de cette démarche sont élevés sans aucun traitement et dans des densités faibles par m3 d’eau, de façon à ce que l’environnement ne soit pas détérioré », assure Philippe Riera, président du groupe Gloria Maris, qui élève notamment du maigre (Corse) et du turbot (Bretagne et Noirmoutier).* On ne parle pas de labels mais de marques ou signes de qualité. Le seul existant est celui du « label rouge », qui offre des garanties d’élevage et de qualité.
Plus d'infos :
www.asc-aqua.org
www.wwf.fr
www.poisson-aquaculture.fr/demarche-qualiteTRIBUNE
TOUT N’EST PAS ROSE DANS LE SAUMON
Par Éric Dehorter, journaliste pour France 3.
© PIXABAY« Saumon : le bio n’est pas irréprochable. » Il y a un an, le titre choc de l’article compilant les résultats des analyses effectuées par 60 Millions de consommateurs semblait jeter le discrédit sur la filière bio. Après avoir analysé dix pavés de saumon frais et quinze variétés de saumon fumé, le magazine concluait à une amélioration de la situation notamment concernant le saumon d’élevage de Norvège mis en cause en 2013 pour l’utilisation dans les élevages conventionnels du diflubenzuron, un insecticide interdit dans l’UE, pour lutter contre la prolifération du pou de mer sur les saumons, du fait de leur promiscuité dans les cages d’élevage. En revanche, tout en étant inférieurs aux normes autorisées, les résidus de métaux lourds (arsenic et mercure) étaient plus importants sur le saumon d’élevage bio que sur celui élevé en conventionnel. Plus surprenant, quatre pesticides organochlorés interdits depuis des années ne se retrouvaient que dans les saumons bio ! De quoi discréditer totalement la filière bio ! Pourtant, à y regarder de plus près, c’est au contraire un plaidoyer pour passer en bio toute l’agriculture au plus vite. Si les saumons bio étaient plus contaminés, c’est parce que la réglementation impose que leur alimentation soit fabriquée avec des farines de poissons sauvages tandis que les croquettes de leurs confrères élevés en conventionnels peuvent contenir en partie des céréales. D’un coté, on essaie de coller le plus possible à l’alimentation du saumon dans le milieu sauvage. De l’autre, on le convertit en partie au végétarisme, évidemment pas par choix éthique mais parce que c’est moins cher ! Du coup, les saumons bio concentrent plus les résidus qui se retrouvent naturellement dans les mers. Au passage, la différence de qualités nutritives induites du fait des différents régimes alimentaires n’était pas étudiée. Conclusion : après avoir utilisé les mers et les océans comme poubelles pour tous nos rejets chimiques depuis des années, aujourd’hui les poissons concentrent ces molécules indésirables surtout en fin de chaîne alimentaire. L’agriculture et l’aquaculture bio n’ont jamais prétendu fonctionner dans une bulle stérile mais au contraire contribuer à ne pas plus salir la planète qu’elle ne l’est déjà ! Chaque année, 5 % des agriculteurs bio sont recalés après contrôle pour contamination croisée. Cette fois-ci, les taux étaient bien inférieurs aux normes, mais demain ? Il y a urgence à ne pas continuer à salir plus l’environnement qu’il ne l’est déjà… en continuant notamment à acheter du bio ! »
Plus vidéo : retrouvez l’émission Prioritaire d’Eric Dehorter sur : france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/prioriterre
INTERVIEW
Frédéric Le Manach, de l’association Bloom :
« Utiliser les déchets de l’agroalimentaire pour nourrir les poissons »Propos recueillis par FD
DR
Frédéric le Manach est directeur scientifique pour Bloom, association qui lutte contre la surpêche. Pour l’ONG, il faut arrêter de nourrir des poissons avec du poisson. La solution : utiliser des déchets pour faire grandir des larves. Et alimenter ainsi saumons, bars et autres espèces carnivores.
Bloom dénonce régulièrement les effets de la surpêche. N’est-il donc pas plus raisonnable de se tourner vers les productions aquacoles ?
C’est une question compliquée car il existe différents types d’aquaculture. Certaines sont tout à fait durables, selon nous. Notamment les élevages de poissons herbivores pratiqués dans des densités décentes. Mais les élevages de poissons carnivores dépendent en grande partie de poissons sauvages, issus de la pêche. Les Chinois consomment beaucoup de carpes, poissons herbivores. C’est aussi souvent le cas en Afrique. En Occident, nous consommons beaucoup de poissons carnivores (saumons, bars, dorades…). Le problème du lien entre pêche et élevage se pose donc surtout en Europe et en Amérique du Nord. Mais nous faisons désormais face à un nouveau facteur : les Chinois se sont rendus compte que les carpes grossissent plus vite et ont meilleur goût quand elles sont nourries avec du poisson. Or la Chine est le plus gros producteur de poisson d’élevage de la planète…
Pourtant les poissons d’élevage consomment de moins en moins de farines issues de la pêche…
Si on prend l’exemple du saumon, il est vrai que les poissons sont nourris avec de plus en plus de matières végétales. Mais on ne peut pas toujours parler d’élevages durables. Car de nombreuses fermes comprennent de grandes densités d’individus traités avec des antibiotiques. Par ailleurs, certains élevages ont recours au soja OGM pour nourrir leurs poissons. Face au problème que représente la surpêche, il nous paraît surtout difficilement justifiable de garder une part de poissons sauvages dans l’alimentation des poissons d’élevage.
Que préconisez-vous ?
Nous pensons qu’il faut réfléchir à l’utilisation de farines d’insectes pour nourrir les poissons. Ce qui permettrait dans un même temps de rendre notre modèle agricole plus vertueux. Aujourd’hui, nous jetons 40 % des aliments que nous produisons. Nous pourrions utiliser une partie des déchets du secteur agroalimentaire pour élever des larves d’insectes. Les larves de mouches sont, par exemple, très résistantes, car elles évoluent dans un milieu « sale ». Elles ont développé un système immunitaire très solide. Les poissons, en les mangeant, bénéficieraient d’une forme d’antibiotique naturel. Et nous n’aurions alors plus besoin d’utiliser des antibiotiques de synthèse pour traiter les élevages.
Plus d’infos : www.bloomassociation.org/dossier-peche-minotiere/