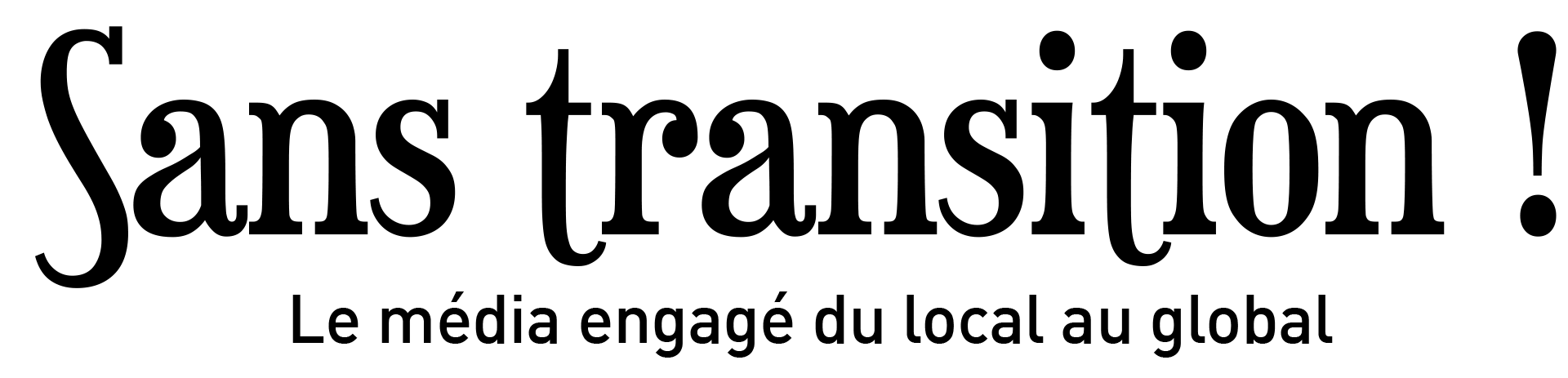Par Catherine Stern
Devenu marginal dans le paysage agro-alimentaire français, l’élevage paysan s’efforce de donner une vie digne aux animaux avant d’y mettre fin. Une résistance face à l’élevage industriel qui occulte toute dimension sensible des animaux comme de celles et ceux qui s’en occupent. Sans transition ! vous emmène dans trois élevages découvrir trois rapports différents aux animaux.
99% des lapins sont élevés de façon industrielle. Jean, installé dans l’Ouest de la France, considère ses lapins comme son outil de travail. Mais se sent aussi maltraités qu’eux.
« Pourquoi je suis devenu éleveur de lapins ? Parce que j’ai vu des annonces de coopératives qui recherchaient des éleveurs et que j’appréciais cet animal, raconte Jean (1), la quarantaine, dans le métier depuis une dizaine d’années après avoir travaillé dans le BTP. Elles nous vendent du rêve : de bonnes conditions de travail, des revenus élevés, mais elles ne disent pas tout… », ajoute-t-il, désabusé, en contemplant les centaines de cages métalliques de 38 centimètres sur un mètre, contenant chacune huit lapins blancs. Ses quatre hangars à la ventilation artificielle, où la distribution d’aliments et le nettoyage des excréments sont automatisés, accueillent des lots de 9 à 10 000 bêtes, dont il s’occupe seul dans l’Ouest de la France. « Il n’y a qu’à surveiller les ordinateurs », explique ce fils de producteurs laitiers. Ce dernier a investi 350 000€ dans ce matériel qu’il n’a pas fini de rembourser. « Toutes les six semaines, 12 000 petits naissent. J’en garde 250 pour être de futures mères, tandis que les autres partent à l’engraissement puis à l’abattoir, décrit-il. C’est la race PS19, sélectionnée pour sa croissance rapide. » Déjà prolifiques, les femelles reçoivent des traitements pour l’être plus encore et ont parfois douze à treize lapereaux alors que leurs mamelles ne leur permettent d’en nourrir que dix. Les autres sont donnés à des mères à la portée incomplète ou étouffés dans des sacs, ce que l’industrie appelle « l’équilibrage des nids ». Et comme la France produit plus de lapins qu’elle n’en consomme, beaucoup de ces bêtes de 73 jours finissent dans l’alimentation des chiens ou des poissons d’élevage… Jean ne mange pas de lapin. « Je mange du bovin, du porc bio, du poulet label, mais pas de l’indus’. Aucun éleveur ne mange de viande industrielle car on sait comment elle est produite », assure-t-il.
Est-ce que Jean est attaché à ses lapins ? « Les petits sont là pour le fric, reconnaît-il sans détour. On ne peut pas s’attacher à des animaux qui ne sont là que quelques jours. On s’attache plus aux mères qui restent deux ans. On s’y attache car c’est notre outil de travail. Il n’y a pas d’émotionnel. Ce n’est pas un animal de compagnie pour nous. » Les problèmes sanitaires qui l’obligent à des injections systématiques d’antibiotiques, Jean les a découverts rapidement. Trop tard pour faire machine arrière à cause de son endettement. De même que l’alimentation fournie par la coopérative à base de sous-produits (résidus déshydratés de canne à sucre, de pulpe de betterave, marc de raisin…), qui donne particulièrement soif aux lapins mais qu’on empêche de boire trop (pour éviter qu’ils gonflent et meurent) en ajoutant du cuivre à l’eau.
Les revenus ne sont pas non plus au rendez-vous : 7 à 9 000 € par an pour un travail 7j/7 et 365j/365. « J’ai gagné 1 000€ par mois l’an dernier, mais beaucoup moins les années précédentes, parce que j’avais plus d’amortissement, se désole-t-il. Pourtant l’élevage est plein à craquer ! On est obligés d’entasser de plus en plus de lapins parce que notre prix de reprise par la coopérative (1,94€ le kilo) n’a pas été augmenté depuis 2017. Et nos charges augmentent. Ce n’est rentable que pour les coopératives qui ont tout racheté (les fabricants d’aliments, les abattoirs…) et font ce qu’elles veulent. » Il montre de gros lapins en expliquant : « Quand les lapins sont trop petits, la coopérative ne nous les paye pas. Et quand les lapins sont trop gros, elle ne nous les paye pas non plus, tout en les vendant quand même parce qu’elle contrôle tout. C’est une honte ! » Jean aimerait arrêter tout cela bientôt pour se consacrer à tout autre chose… ou militer contre l’élevage intensif et éviter à d’autres les mêmes déconvenues que lui.
(1) Le prénom a été changé.
Valeria Vassalli élève des bovins à viande de façon extensive dans l’Aude. Elle s’efforce de respecter les besoins de ses vaches, avec la conscience que son élevage doit être performant.
« Ma relation avec mes vaches se base sur la connaissance de la bête. Elles sont faites pour manger de l’herbe. On leur donne une vie digne, en leur permettant de grandir à l’extérieur, de bouger, de vivre selon leur système. C’est une bonne base pour une bonne relation et j’aime avoir des vaches qui sont en confiance avec nous, raconte Valeria Vassalli, Suisse italienne de 40 ans - dont 21 ans à s’occuper des vaches -, installée avec sa famille à Camps-sur-l’Agly (Aude), près de Bugarach. « Toutes les vaches ont leur nom. Celle-là s’appelle Latina », poursuit-elle en montrant une des soixante vaches allaitantes gasconnes qui broutent, avec 70 génisses et veaux, les 250 hectares de pâturages que le couple a repris en 2021 dans cette zone de causse. Mamans et petits bénéficient aussi de deux estives au-dessus de 1500 mètres d’altitude. Valeria observe les bêtes, les soigne avec des huiles essentielles, essaye de leur garder une bonne immunité et leur éviter les vers grâce à des cures de chlorure de magnésium, de vinaigre de cidre, de minéraux et d’ail. Elle s’occupe aussi des vêlages, tandis que son conjoint Martino a en charge le reste. « Quand le pis commence à sortir, cela indique que le vêlage est pour dans un bon mois, explique celle qui se dit amoureuse des animaux et des grands espaces depuis l’enfance. Quand elles sont prêtes, on les rentre car si les veaux naissaient à l’extérieur, notre rapport avec eux serait plus compliqué. »
Dans le hangar près de l’habitation de Valeria, des veaux sevrés attendent le départ. Ils restent avec leur mère jusqu’à huit-neuf mois puis « c’est le renouvellement », explique-t-elle. Sur soixante naissances, une quinzaine de veaux peuvent être vendus en direct avec un abattage local (mais la viande rosée des veaux qui ont accès à l’herbe est peu appréciée de la clientèle), tandis que le reste part à l’engraissement. « Malheureusement, on les vend à Arterris, une grosse coopérative, regrette-t-elle. Ce qui m’embête le plus, c’est qu’une partie va aller en système intensif en Espagne, en Italie et même au Maghreb. J’aimerais bien ne pas voir mes veaux partir ni les vaches réformées faire 600 km pour être abattues dans les Deux-Sèvres. Mais on ne peut pas faire autrement. »
Valeria sait que son élevage doit être « performant », pour payer ses crédits et gagner sa vie. Sans croire tout à fait que des élevages familiaux comme le sien pourraient nourrir tout le monde, elle a conscience que « ses vaches sont sûrement plus heureuses que des cochons ou poules en batterie. » Son souhait : revenir à un système plus local, que les éleveurs puissent vivre de leur métier sans dépendre des aides de la Pac (1). « Lorsque ma voisine était petite, ils étaient neuf autour de la table et élevaient cinquante moutons sans aide, raconte cette mère de deux garçons qui ne part jamais en vacances. Alors qu’aujourd’hui, même avec soixante vaches et 250 hectares, on doit rembourser les banques dont on est dépendants. Et on est presque pauvres. »
(1) Pac : politique agricole commune (européenne).
Dans la banlieue de Rennes, Denis Cohan combine élevage extensif de bovins à viande et industriel de cochons et de poules reproductrices (qu’il vient d’arrêter).
A 55 ans, Denis Cohan vient d’arrêter son élevage industriel de poules reproductrices démarré en 1995, à cause du changement de conditions imposées par le groupe belgo-danois BD France, qui a racheté son intégrateur. « Soit vous investissez 250 000€, soit on vous vire, témoigne l’éleveur, membre du bureau de la Confédération paysanne d’Ille-et-Vilaine. J’en aurais repris pour dix ans, pendant lesquels ils m’auraient mené à la baguette. J’ai dit stop ! ». Denis est la quatrième génération à exploiter la ferme familiale. Le bâtiment de 1 300 m² qu’il y a fait construire pour accueillir 8 200 poules et 800 coqs (7 au m²), où il passait quatre heures par jour, est désormais silencieux. « En volaille, 70% des élevages sont ‘’intégrés’’ faute d’avoir une trésorerie suffisante, explique-t-il. Il détaille : l’intégrateur nous amène les coqs et les poules prêtes à pondre à vingt semaines, l’aliment, récupère les œufs, et nous rémunère par rapport au travail et au résultat technique (le taux d’éclosion par lot). Les lots durent 62 à 63 semaines puis les poules, plus assez productives, sont ‘’réformées’’ et partent en Pologne (1) pour être abattues. Les œufs sont expédiés dans un couvoir (BD France en a racheté un peu partout en France). Trois semaines après, les poussins sont redistribués dans des centres d’engraissement dans la France entière, pour faire des poulets, ainsi que pour la restauration hors domicile type McDo. En juin 2022, alors qu’on a été repris avec des contrats à la baisse de 8%, j’ai terminé le lot en cours et j’ai arrêté. »
Le bâtiment rapporte encore grâce aux panneaux photovoltaïques dont il est couvert, comme les autres bâtiments. Dans l’un d’eux, il engraisse 225 porcs (un petit élevage comparé aux « gros « qui peuvent en engraisser 3, 5 ou 10 000). Le naisseur lui apporte des porcelets de 25 kg et ils repartent trois mois et demi plus tard en pesant 110 kg. Ils vivent sans accès à l’extérieur, à 25 par case (1,15 m² par cochon) dont une partie est ajourée pour évacuer les excréments et le reste en béton, alimentés par des nourrisseurs. Un attachement pour ces animaux ? « Non. C’est de l’élevage industriel », reconnaît-il.
Les bêtes avec qui Denis Cohan a le plus de liens, ce sont ses vaches, des Limousines et des Salers, dont les plus âgées ont quinze ans. Elles vivent à l’extérieur neuf à dix mois par an, sauf quand elles risquent d’abîmer les prairies. « On connaît leur caractère. On s’attache plus », souligne-t-il. Les mères restent tant qu’elles sont fertiles, alors que les broutards (2) partent à l’engraissement à huit mois puis sont abattus. Même s’il estime avoir gagné correctement sa vie (3 500€ par mois dont un tiers provient du photovoltaïque) avec la ferme dans laquelle il exploite aussi 42 hectares de culture en bio, il sait qu’il n’ira pas au bout de sa carrière avec des animaux. Il, préfére retourner dans le salariat hors agriculture : « les animaux, c’est une contrainte énorme ! Tous les jours il faut y être. » Il gardera des poulets pour la consommation familiale. Critique sur son élevage intensif, c’est la seule viande qu’accepte parfois de manger sa fille.
(1) Car la France ne possède plus d’abattoirs adaptés à l’abattage des poules pondeuses réformées, plus âgées donc plus grosses que les poulets de chair.
(2) Un broutard est un jeune bovin (ou ovin) de race à viande qui se nourrit de lait maternel et d'herbe jusqu'à son sevrage.
Vers le transanimalisme
Les poulets à croissance ultra-rapide, utilisés dans les élevages industriels, atteignent 1,8 kg en 35 jours : une croissance quatre fois plus rapide que dans les années 1950. Et les poules pondent plus de 330 œufs par an contre une vingtaine à l’état sauvage. Ce qui permet des économies d’aliment et de main-d’œuvre. Conséquences : une poitrine surdéveloppée, des difficultés à se déplacer, des défaillances cardiaques et respiratoires, et des douleurs intenses pendant leur courte vie. Au point que les associations comme CIWF, Welfarm, l’OABA et L214 demandent l’interdiction de ces « souches ». Dans l’élevage intensif, « il s’agit de multiplier dans des proportions allant parfois de un à dix la production de lait, d’œufs et de viande, souvent au détriment du fonctionnement biologique, social et émotionnel des animaux, entraînant de grandes souffrances », explique Anne-Laure Thessard, philosophe chargée de cours à Sorbonne-Université dans son texte « vers le transanimalisme » (1). Elle explique que cette notion « est applicable à tout type d’animal à qui l’on applique des techniques et technologies issues des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives (NBIC), dans le but de les augmenter physiquement et/ou cognitivement » L’autrice cite aussi des recherches dans les laboratoires sur les embryons hybrides cochon-humain, afin d’obtenir des animaux « banques d’organe ».
(1) Dans l’ouvrage collectif « Psychologie des animaux », sous la direction de Jean-François Marmiton, Ed. Sciences humaines, 2022.