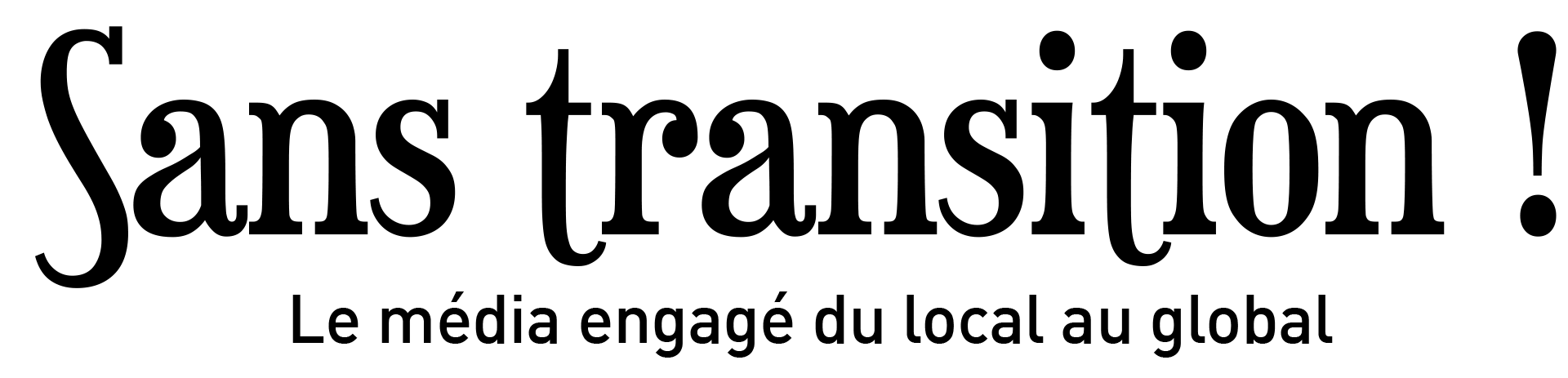Propos recueillis par Magali Chouvion
Sans eau, pas de vie sur Terre. Si le constat est partagé, nous semblons pourtant l’avoir oublié dans une gestion économique libérale de la « ressource » en eau. Au point de nous retrouver, dans chaque partie du monde, en proie à des difficultés de disponibilité pour vivre et pour assurer nos activités économiques. Il est urgent de réagir, martèlent trois spécialistes de l’eau, que ce soit dans le monde politique, économique, ou dans notre manière de faire monde.
Lisa Belluco est inspectrice de l'environnement de profession et militante écologiste. Elle est également co-présidente de l'institut Cité Écologique. Elle est élue députée de la Vienne en 2022 sous la bannière EELV.
Esther Crauser-Delbourg est économiste de l'environnement, spécialisée dans les questions de ressources en eau. À travers sa thèse obtenue à l'École polytechnique et à l'Earth Institute de l'Université de Columbia à New York, elle travaille sur les questions de conflits d'eau entre pays transfrontaliers et à l'utilisation de l'eau pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Elle est également consultante indépendante.
Sophie Gosselin est philosophe. Elle enseigne à l’EHESS à Paris et participe à l’Université populaire pour la Terre. Elle est membre fondatrice de la revue Terrestres. Elle publie, avec le philosophe David gé Bartoli, La Condition terrestre. Habiter la Terre en communs (Le Seuil), une réflexion à propos d’autres manières de se relier à la Terre et à l’ensemble des entités qui la peuplent.
Avec le manque, l’humain semble redécouvrir l’importance de l’eau pour sa vie. Comment expliquer que nous nous soyons ainsi coupés de l’eau ?
Sophie Gosselin : Les êtres humains se sont toujours installés près de l’eau, qu’il s’agisse d’un fleuve ou de la mer. Mais selon les sociétés ou les cosmologies [manières dont les êtres humains font monde avec d’autres formes de vie, NDLR], ils n'ont pas toujours considéré l’eau comme une ressource ou une chose, c’est-à-dire comme quelque chose d’extérieur à la société humaine, et que l’être humain peut s’approprier pour ses usages. On retrouve d’ailleurs cela dans le vocabulaire scientifique : masses d’eau, stock, quantité mesurable… Il s’agit à chaque fois d’une vision objectivante qui renvoie à une vision économique. Car lorsqu’on parle de l’eau comme d’une ressource, on réduit une puissance naturelle à une force que l’on peut exploiter et mettre au travail au service de la consommation humaine. Nous avons oublié que c’est l’eau qui permet la vie de tous les êtres et des communautés.
Esther Delbourg : Effectivement, nous avons besoin de l’eau pour vivre, mais aussi pour produire. Et il y a souvent confusion entre l’eau qui relève du droit humain — qui peut être considérée comme un commun —, et celle qui relève du droit économique. Aujourd’hui, on ne distingue pas assez ces deux eaux. Nous ne le savons pas, mais l’eau est le premier produit que l’on importe et exporte dans le monde à travers l'agriculture. Elle est ponctionnée comme toute autre ressource, mais sa gestion est négligée. Elle n’est pas monétarisée, ni régulée, alors qu’elle fait partie intégrante de toute économie. Notre rapport à l'eau est très contradictoire en ce sens.
Iriez-vous jusqu’à dire qu’il faudrait donner un prix à l’eau ? On aimerait plutôt la considérer comme un bien commun.
Esther Delbourg : Attention à bien distinguer les deux types d’eau. D’abord l’eau domestique, indispensable à nos besoins primaires. L'accès à cette eau est reconnu comme un droit par l’ONU. On estime qu'il faut 20 à 25 litres par personne et par jour pour vivre dignement — en France, nous sommes autour de 150 litres d’eau. Il est ici essentiel de disposer d'infrastructures qui permettent son acheminement pour garantir des conditions dignes à tous. Cette eau correspond à environ 20 à 30 % de l’eau dans le monde.
Le second type d’eau est l’eau matière première pour l'industrie et l'agriculture. Cette eau est utilisée pour produire des biens qui vont être vendus et relève d’un droit économique, comme toute matière première, le capital, la main d’œuvre… Par exemple, lorsque l'on consomme des avocats produits au Pérou, nous consommons virtuellement l'eau de ce pays qui pourtant en manque drastiquement. Si l'eau avait un prix relatif à sa rareté locale, peut-être qu'importer ces avocats reviendrait trop cher aux consommateurs. La valeur de l’eau n’est pas prise en compte comme le sont les intrants, les machines, la main d’œuvre... C’est à cette eau-là que les économistes s’intéressent et souhaiteraient, pourquoi pas, donner un prix, comme pour le carbone.
En quoi le manque d’eau et le réchauffement climatique sont-ils liés ?
Esther Delbourg : Les scientifiques du GIEC estiment que 90 % des enjeux climatiques sont liés à l'eau. D'ailleurs, la vapeur d’eau est bien le premier gaz à effet de serre. L'augmentation des températures accélère la sécheresse des sols et l'évaporation de l'eau qui, à son tour, charge l'atmosphère et provoque, de façon incontrôlée, des phénomènes hydrologiques beaucoup plus intenses, ce qui intensifie le changement climatique. On parle d’emballement.
Lisa Belluco : La Vienne, où j’habite, est une zone de répartition des eaux, c’est-à-dire une zone de tension sur la ressource. Pourtant, même ici, la majorité des agriculteurs affirme qu’« il tombe autant d’eau qu’avant ». Mais c’est faux ! Il y a certes eu une première phase durant laquelle il y avait la même quantité d’eau sur une période plus courte ; mais, maintenant, il tombe moins d’eau. Du moins chez nous. Les jeunes en prennent conscience mais, chez les politiques, on est sur une autre planète ! Malgré une préoccupation montante ces dernières années, il y a encore ce discours obsolète comme quoi l’eau serait abondante sur une courte période et doit être captée dans des méga-bassines. Il s’agit d’un déni de la réalité.
Esther Delbourg : Comme pour la nourriture, nous avons encore assez d’eau pour couvrir l’ensemble de nos besoins. Le problème, c’est notre utilisation : 20 à 50 % de notre consommation est gaspillée. Par exemple, dans la viticulture, ces dix dernières années, du fait de l’intensification de la production agricole et du réchauffement climatique, on a prélevé trois fois plus d’eau que lors du siècle précédent. Et ceci est valable sur l’ensemble du système agricole mondialisé. Il est plus que temps de faire appel à notre intelligence et de faire preuve de parcimonie.
À l’instar du réchauffement climatique justement, nous savons depuis des années que nous allons manquer d’eau. Comment expliquer que nous n’ayons pas agi avant ?
Lisa Belluco : Pour moi, c’est tout simplement incompréhensible ! Comment font les politiques pour répéter ainsi le message des lobbies qui disent que nous pouvons continuer à utiliser l’eau sans rien changer ? Je ne vois que deux possibilités : soit ils sont cyniques, soit ils y croient. Dans les deux cas, ce n’est pas très encourageant. Concernant l’eau et sa pollution, par exemple, on a eu un débat hallucinant à propos des PFAS à l’Assemblée qui se résumerait en : « mais si on interdit l’usage des PFAS, quel sera l’impact sur l’économie ? ». On parle quand même de polluants éternels néfastes aux écosystèmes et à la santé humaine ! Et la seule question qu’on se pose, c’est si on ne va pas détruire l’économisation de nos modes de vie !
Sophie Gosselin : J’explique ces réactions par le fait que notre système politique et social moderne s’est bâti sur une coupure avec nos conditions d’habiter. Toute une série d’infrastructures économiques ne cessent de nous couper de ce qui nous permet de vivre en substituant aux interdépendances terrestres des dépendances à un système de production et à un marché hors-sol et globalisé. Le milieu de vie est considéré comme pure extériorité. Tant et si bien que nous n’avons plus aujourd’hui aucune prise populaire sur nos conditions d’existence. Nous l’avons bien vu à Sainte-Soline ce printemps : la question de l’eau y est devenue une question politique majeure. De quoi vit-on finalement ? De quoi sommes-nous dépendants ? Autant de questions qu’il est grand temps de se poser collectivement, là et où nous habitons.
Esther Delbourg : Je rajouterais à ces arguments le fait que l’eau a toujours été considérée comme un problème local. Le fait qu’il manque de l’eau au Niger ou en Espagne n’a jamais été une préoccupation française, par exemple. Or nous sommes tous liés par nos ressources en eau. Je suis ainsi affectée par les sécheresses aux États-Unis car je consomme virtuellement cette eau-là à travers les oranges ou les avocats. S'il manque de l'eau, alors leurs prix vont augmenter ou leur production s'interrompre. À titre d'exemple, la France importe presque l'équivalent en net du volume d’eau de la Seine chaque année. Cette dépendance mondiale est une idée peu considérée encore.
À l’échelle mondiale, l’eau — qu’elle soit domestique ou économique — est souvent privatisée et accaparée. Avec quelles conséquences ?
Sophie Gosselin : Privatiser l’eau n’est pas envisageable. À l’instar de la terre ou de l’air, l’eau est un bien commun. Rien ne justifie qu’elle nous appartienne à nous, humains, plutôt qu’à d’autres espèces. Nous appartenons à la Terre et nous devons faire alliance avec tous les autres vivants en réinventant des formes de co-habitation qui tiennent compte et respectent les différents besoins.
Esther Delbourg : Je suis d’accord. De façon générale, l’idée de privatiser l’eau est difficilement entendable. Mais je tiens à préciser un point : en France, lorsque Veolia ou Suez acheminent de l’eau potable jusqu’au robinet, ces entreprises sont propriétaires des réseaux et de la gestion, mais pas de l’eau en elle-même. Il y a un vide juridique là-dessus.
Toujours est-il qu’auparavant, ces réseaux et cette gestion appartenaient à la sphère publique. Mais depuis quelques années, tout se privatise. L’un des exemples les plus marquants de la privatisation de l’eau potable est l’Angleterre. Dans les années 80, Margaret Thatcher a tout privatisé, dans une démarche affichée de recherche du profit. Aujourd’hui, très nombreuses sont les voix citoyennes qui affirment que cette décision a été désastreuse : l’eau anglaise serait de mauvaise qualité et pas disponible pour tous.
Lisa Belluco : En France aussi, on a privatisé à tour de bras ! L’entreprise Vittel, par exemple, est propriétaire des sources qu’elle exploite. L’eau y a été surconsommée et les nappes dégradées aux alentours, au détriment des populations locales. Mais la situation est encore pire dans d’autres endroits du monde. Au Chili par exemple, c’est 100 % de l’eau qui est privatisée, et donc les fleuves et les cours d’eau ! Tant et si bien que, si vous n’avez pas les moyens, vous ne pouvez pas produire d’agriculture…
Esther Delbourg : C’est exact. Dans les grands pays en voie de développement, l’eau est accaparée par quelques-uns. Mais, avec les tensions naissantes, cet accaparement se fait aussi sentir en Europe. L’accaparement de l’eau en Inde ou au Mexique par des géants de l'agroalimentaire se fait au détriment des populations locales, et certains comparent ces situations avec l’accaparement de l’eau des méga-bassines par quelques agriculteurs en France, au détriment de tous les autres.
Sophie Gosselin : Nous sommes dans une nouvelle étape d’enclosure, c’est-à-dire l’accaparement par une minorité de possédants de ressources en voie de raréfaction. Toute l’histoire du capitalisme depuis sa naissance n’est qu’une série d’enclosures. Mais cette fois-ci, ce qui se joue est peut-être encore plus vital, du fait du réchauffement climatique et de la catastrophe écologique.
Considéreriez-vous que les manifestations de Sainte-Soline s’opposent, justement, à cette enclosure ?
Sophie Gosselin : Tout à fait. Des citoyen·ne·s, des habitant·e·s, se sont battu·e·s — et se battent encore — pour empêcher un accaparement de communs. Or la seule réponse que le gouvernement leur a apporté, c’est de la répression. Ce pouvoir autoritaire sur des combats écologiques est très dangereux et inacceptable. Tout notre système politique moderne est fondé sur la promesse du progrès. À partir du moment où cette promesse ne tient plus, il n’a plus de légitimité. Les peuples doivent se ressaisir de cette question et instaurer plus de démocratie à l’échelle des territoires ; des processus décisionnels populaires qui se définissent depuis les milieux de vie.
Lisa Belluco : J’étais aux manifs de Saint-Soline en mars, mais aussi en octobre 2022. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette lutte, c’est que des personnes, qui ne se seraient pas forcément croisées ailleurs, œuvrent à un but commun dans le collectif Bassines Non Merci. Politiques, paysans, activistes… se battent ensemble contre une forme d’agriculture ultra-minoritaire. Seule 7 % de la surface agricole utile est irriguée. De plus, justifier une partie du financement de ces méga-bassines par les agences de l’eau, et donc par nos redevances à tous, est compliqué.
Connaissez-vous d’autres exemples de gestion plus vertueuses, qui permettent un meilleur partage de l’eau ?
Esther Delbourg : Je pense qu’il faut désormais mettre en place des systèmes de gouvernance à différents niveaux : locaux, régionaux, nationaux et même supra-nationaux, où tous les usagers (des foyers aux agriculteurs, des communes aux industriels) seraient concertés. La concertation ne pourra d'ailleurs exister que si l'on gère l'eau au niveau plus local, par bassin versant. C'est ce qui est en train de se passer autour du Nil, par exemple. Alors que l'Égypte avait déclaré siennes ses eaux depuis les années 1920, l'Éthiopie a finalement pu construire un barrage en amont et produire de l'électricité. S'il y a encore beaucoup à faire, l'eau est devenue un bien économique partagé et régulé.
Sophie Gosselin : Sur la même idée, les choses commencent à évoluer en France face au paradigme de la gestion de l’eau comme une ressource extérieure. Sur la Loire a été créé le Parlement de Loire. Il s’agit d’une expérimentation, basée sur l’imagination, qui permet une gestion du fleuve par son peuple. C’est-à-dire par toutes les personnes qui dépendent du fleuve pour vivre et exister. Bientôt une autre étape va advenir avec la création de véritables assemblées de l’eau. La mise en place de cette autorité compétente est indispensable car absente aujourd’hui de toute législation.
Lisa Belluco : Au niveau de la politique locale aussi des choses sont possibles. Le fait de gérer l’eau en régie publique, plutôt qu’en délégation de service public ou concession, est une bonne chose. Le prix au consommateur peut être maîtrisé, et les priorités d’investissement viser autre chose que la rentabilité maximale. Et puis une tarification progressive de l’eau peut aussi être adoptée, en prenant en compte les écueils techniques qu’elle demande évidemment.
Esther Delbourg : Et nous devons aussi absolument réfléchir à notre gestion de l’agriculture, puisqu’elle est à la fois la plus grande consommatrice d’eau et indispensable pour nous nourrir. Norvège, Suisse, Finlande… on parle souvent des pays d’Europe du Nord comme des plus vertueux dans leur gestion de l’eau. Ils cumulent tous des sources de qualité et des institutions solides. Cependant, ce ne sont pas de grands pays agricoles. Leur problématique n’est donc pas la même que pour des pays comme la France qui doivent produire en quantité tout en s’adaptant aux nouvelles conditions climatiques. Pour équilibrer cela, peut-être pourrait-on mettre en place une régulation européenne des cultures au niveau régional ? C’est-à-dire définir quelle partie de l’Europe est la plus apte à produire des fraises, par exemple, des tomates ou des choux-fleurs, en fonction de son terroir et de ses conditions météorologiques.
La Banque mondiale estime à 114 milliards la somme nécessaire pour remplir ses objectifs en matière d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, dans le monde. Comment financer une telle somme ?
Sophie Gosselin : Annoncer des milliards qui stupéfient tout le monde n’a aucun sens. Il ne s’agit ici que d’annonces à visée politique. Il serait préférable de fournir aux collectivités territoriales, à l’échelle plus locale, des moyens pour permettre à des assemblées de territoire de se constituer. Grâce à ces nouvelles organisations partagées et proches du terrain, la gestion de l’eau serait bien plus efficace, plus juste et plus légitime.
Lisa Belluco : Je suis d’accord. On nous parle de milliards alors que, si on réglait déjà la question des pesticides, on aurait fait l’essentiel ! Car en France, nos problèmes d’eau — tant en termes de qualité que de quantité — proviennent essentiellement des consommations et pollutions agricoles, bien plus que celles, industrielles, qui sont mieux cadrées (lire page 74). Utilisons plutôt de l’argent pour transformer le système agricole actuel vers le modèle agroécologique. Replantons des haies, favorisons l’agroforesterie, rendons leurs lits aux cours d’eau… tout cela pour retenir l’eau dans les sols. Certes, ce n’est pas l’unique solution, mais cela résoudrait beaucoup de problèmes.
Esther Delbourg : Il faudrait que les acteurs financiers se mobilisent en parallèle. Car il n’existe aujourd’hui aucune régulation financière de l’eau. Alors que les grands investisseurs exigent désormais des bilans carbone des entreprises, il n’existe rien de tel pour l’eau. Nous sommes incapables de déterminer sa valeur. Tant que cette métrique n’existera pas, il ne pourra pas y avoir de régulation. Attention, il n'est pas question de monétariser l'eau pour en faire un bien échangeable, mais de la valoriser pour mieux en maîtriser les usages.
À l’instar des terres que nous devons partager, nous semblons avoir oublié les autres êtres vivants dans leur accès à l’eau. Pourquoi le partage de cet élément vital est-il si difficile à imaginer ?
Sophie Gosselin : Notre modèle politique et anthropologique, en contexte occidental, s’est créé à partir d’une division des terres par et pour les êtres humains. Notre modèle industriel, de fait, est aussi né de ce partage. Or l’eau est un flux qui circule et fonctionne en cycles. Elle ne peut pas entrer dans ce modèle. Lorsqu’on parle de ressources en eau, de stock, d’utilisation… on pense toujours l’eau en termes d’objet au service des usages. On devrait plutôt penser à partir des cycles de l’eau et voir quelle pratique agricole, quel usage, respecte ces cycles. La souveraineté politique reste terrienne, fixe. Alors que l’eau est poreuse, fait bouger les frontières... Si on commence à imaginer à faire peuple et communauté depuis la circulation des eaux, via une démocratie directe, tout est remis en question.
Lisa Belluco : Je pense que nous n’avons toujours pas compris que nous sommes à l’intérieur du Vivant, et pas au-dessus ou à côté. À l’instar des terres que nous départageons entre quelques espaces préservés pour la biodiversité et tous les autres pour nos usages, on considère d’abord l’eau pour nos besoins, et ceux du reste du Vivant auront les gouttes restantes. On ne réalise pas bien que l’eau, c’est tout : la vie et toutes nos activités. C’est peut-être justement parce qu’on la voit en « ressource » et pas en commun. Le vocabulaire est important.
Esther Delbourg : Nous allons même au-delà de la gestion de la ressource ; jusqu’au contrôle. L’humain se targue d’être un animal conquérant. Plus on réussit à contrôler la nature, moins on en a peur. Et l’eau est depuis toujours un sujet de fascination que nous essayons de maîtriser. Il n’y a qu’à voir l’enthousiasme général ressenti devant un grand barrage hydroélectrique. Mais elle peut aussi nous détruire facilement quand on recherche un rapport de domination. Ne l’oublions pas.
PLUS D’INFOS :
Collectif Bassines Non Merci : bassinesnonmerci.fr
Parlement de Loire : polau.org