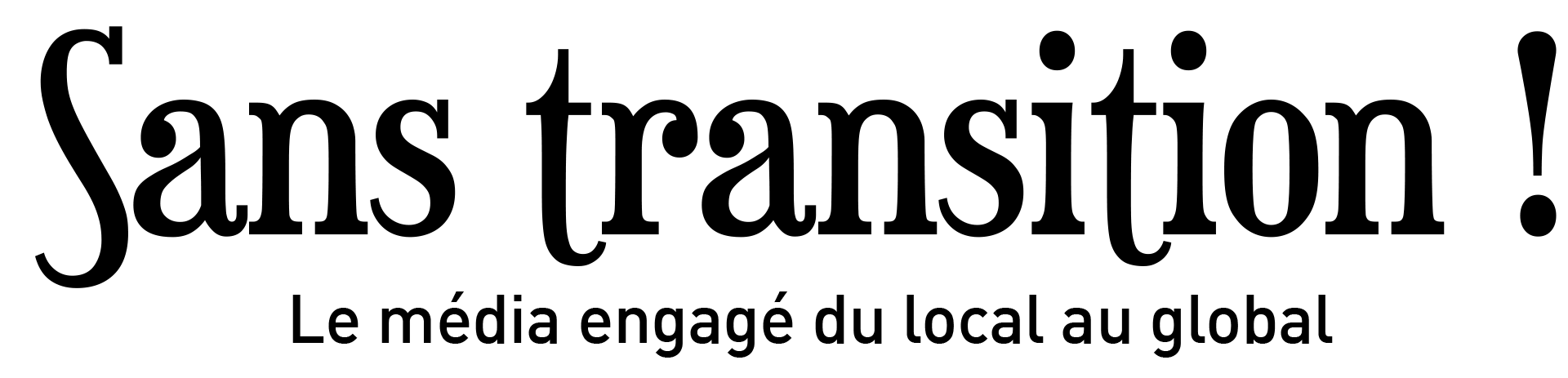Propos recueillis par Magali Chouvion
Comment l’humain a-t-il construit ses relations complexes avec les animaux au fil des âges ? Que disent ces relations de notre rapport au Vivant ? Interdisent-elles certains actes ou au contraire nous libèrent-elles de par notre appartenance commune à la biodiversité ? Que disent-elles de notre enjeu d’existence ? Pour tenter de répondre à ces questions, trois philosophes nous questionnent sur ce qui, au final, fait notre humanité.
Dominique Bourg est philosophe, enseignant à l’Université de Lausanne et directeur de la revue La pensée écologique. Il est une voix forte de l’écologie intégrale qui défend l’idée que la transition écologique passera par une révolution intérieure. Enfin, il s’est présenté aux élections européennes de 2019 sur la liste Urgence Écologique à côté de Delphine Batho.
Florence Burgat est philosophe, directrice de recherche à l’ENS (Paris). Elle a été co-rédactrice en chef de la Revue Semestrielle de Droit Animalier (2009-2019). Elle travaille notamment sur les approches phénoménologiques de la vie animale et sur le droit animalier.
Jean-Philippe Pierron est philosophe, enseignant à l’université de Bourgogne où il dirige le master Humanités médicales et environnementales. Il est membre du conseil scientifique du Campus de la Transition (Forges). Ses recherches, entre poétique et éthique, explorent l’importance des médiations imagées et le rôle éthique de l’imagination en écologie ou médecine.
L’être humain et l’animal ont toujours eu des relations. Comment ont évolué et se sont construits ces rapports au fil du temps ?
Dominique Bourg : Tout à fait. Il n’y a pas d’histoire humaine sans relation à l’animal. Nous avons toujours vécu avec la nature et avec les éléments qui la constitue : animaux, végétaux et autres humains. Néanmoins, nous pouvons distinguer trois étapes dans cette histoire.
La première a duré jusqu’à la domestication du loup, c’est-à-dire jusqu’à il y a environ 40 000 ans. Nous vivions à côté des animaux, les chassant lorsque nous en avions besoin. Rien de plus.
Puis est advenue la révolution néolithique qui correspond à l’invention de l’agriculture et de l’élevage, et donc à la domestication des plantes et des animaux. Il en résulte des modifications très importantes des sociétés qui se sont étalées sur des milliers d’années. Les animaux « domestiques » ont été créés. Et c’est finalement toute notre relation à la nature qui a changé, avec la domination d’une espèce sur les autres, d’un genre sur l’autre et des riches sur les pauvres avec l’esclavage.
Aujourd’hui, nous sommes dans l’étape moderne, qui dure depuis la fin du XVIe et le début XVIIe siècle, avec l’avènement de la physique moderne. Tout ce qui est nature est ravalé à de la pure matière. Les animaux, comme les plantes, sont considérées comme des machines (1). Face à l’humain qui a une sensibilité et un langage. C’est la posture despotique de la Genèse : l’homme est le seul être vivant créé à l’image de Dieu. La fin du XIXe siècle marque l’apogée de cette thèse, avec la mécanisation de l’agriculture et de l’élevage, que l’on retrouve dans les grands abattoirs de Chicago (150 hectares de parcs à bestiaux, 80 % du commerce de viande aux USA) ou les traités de zootechnie. Pour mémoire, on enseignait encore il y a dix ans à l'Ecole vétérinaire d'Alfort à pratiquer une césarienne sur une vache sans l’anesthésier.
En résumé, la modernité a repris toutes les dominations du néolithique en se construisant contre l’esclavage. Quant à la démocratie, elle permet d’esclavagiser la nature pour échapper à l’esclavage d’êtres humains.
Florence Burgat : Les travaux des paléoanthropologues nous permettent d’affirmer que notre rapport aux animaux a toujours été violent. Les modèles pacifiés n’ont jamais existé.
Durant la Préhistoire, les premiers hominidés étaient ce que les paléoanthropologues appellent des « opportunistes » : ils mangeaient ce qu’ils trouvaient, des plantes, racines, œufs, mollusques… Le « grand chasseur », thème quasi mythologique chez les préhistoriens de la première heure, n’est apparu qu’à des époques plus tardives. On peut penser que les hommes qui chassaient à des fins alimentaires n’avaient pas forcément de plaisir à le faire à l’époque. Mais notre rapport aux animaux aurait évolué lors du passage de cette chasse de subsistance à une chasse de loisir. Konrad Lorenz fait l’hypothèse que les armes à feu, en nous évitant de tuer à mains nues, ont entraîné un accroissement de la violence, car tout individu n’est pas prêt à tuer de ses propres mains ; il en va tout autrement lorsqu’il ne s’agit que d’appuyer sur une gâchette. L’inhibition naturelle que tout individu normal possède se trouve alors levée. Les humains ont pu s’en donner à cœur joie, si l’on peut dire, et notre relation aux animaux n’a alors cessé de se dégrader.
Le développement des sciences et techniques n’a émancipé les animaux que des tâches maintenant mieux accomplies par des machines. Elles les soumettent aujourd’hui à bien d’autres épreuves, notamment dans le domaine de la recherche expérimentale, ou encore les modifient sur le plan génétique pour les façonner en vue de tel ou tel usage ou performance. Nous n’avons jamais mutilé et tué autant d’animaux qu’aujourd’hui. Alors que n’avons jamais eu autant de connaissances sur eux ni autant conscience du mal que nous leur faisons.
Jean-Philippe Pierron : Face à ces constats, selon moi la question est maintenant : comment traduit-on en mode d’organisation socio-politique acceptable ce que l’on sait des expériences vécues des animaux. Il s’agit d’un défi culturel. Si on identifie que les animaux sont capables de mondes vécus spécifiques – et que ça compte -, comment s’organise-t-on, nous les vivants humains qui vivons avec eux, pour ne pas les exploiter, ni les dominer, ni les réifier ? Finalement comment passe-t-on du phénoménologique (expérience vécue par un sujet ou un vivant, NDLR) au politique ? Quels sont les processus de traduction de l’un à l’autre, d’un mode d’être originel à des manières de faire société ? C’est l’un des points que j’explore dans mon dernier livre sur l’écobiographie.
Vos réponses s’appliquent-t-elles à l’ensemble du Vivant ?
DB : Évidement ! Et je tiens à préciser que nous ne devons pas nous focaliser sur l’animal et les relations que nous entretenons avec lui. Les végétaux ont, eux aussi, toutes les fonctions de l’animal : communication, intelligence, sensibilité… Au contraire des véganes qui restent dualistes, je prône une réelle continuité du Vivant.
JPP : Si notre relation au vivant a évolué, cela tient à notre nouveau rôle dans l’histoire des vivants. Quelle place particulière occupe aujourd’hui le vivant humain dans l’ensemble du monde des vivants ? Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a répondu à cette question en décembre 2022, nous définissant comme « une arme d’extinction massive ». Ou comment, dans l’Anthropocène, l’humanité envisagée comme espèce est devenue une espèce prédatrice, à l’origine d’extinctions massives.
FB : Je récuse effectivement ce thème de Vivant dans la mesure où il est tellement large qu’il inclut des entités très hétérogènes. Nos relations avec les autres entités vivantes sont très différentes selon l’entité dont il s’agit. J’ai notamment essayé de montrer dans mon livre Qu’est-ce qu’une plante ? (2020) qu’il existe une différence absolument radicale entre les plantes, qui ne ressentent pas les émotions et sont non-sentientes, et les animaux. Ma réponse concerne donc uniquement les animaux.
Pourquoi mangeons-nous certains animaux ? En ignorons-nous d’autres et enfin en exterminons ou en choyons les derniers ? Existe-il une échelle de valeur entre les différents animaux que nous côtoyons ?
FB : Ces différences ne sont pas universelles et la frontière entre un animal de compagnonnage, par exemple, et un animal de boucherie, est tout à fait artificielle. Elle est le fruit d’une construction sociale. Prenons le cas du cheval. Certains ont une relation interpersonnelle avec lui qui leur permet de prendre pleinement conscience de la vie psychique de l’animal, de ses émotions. Ces personnes, en général, ne mangent pas de viande de cheval. Pourtant, il existe des boucheries chevalines. Pourquoi ceux qui ne mangeraient jamais les chevaux mangent-ils les cochons, les bovins, les poules, les oies… qui sont des animaux tout aussi complexes et sensibles que les chevaux ? L’histoire de l’alimentation révèle que l’on trouvait sur les meilleures tables le héron, la grue, la corneille, la cigogne, le cygne, le cormoran, le butor, le paon, dont le célèbre Taillevent, premier cuisinier de Charles VI, expose les façons de les accommoder dans ses traités de cuisine ; les oiseaux de proies eux-mêmes n’étaient pas dédaignés.
Cette incohérence de traitement est encore plus visible avec les enfants, auxquels l’on offre des peluches d’animaux que, en même temps, on leur fait manger. Il y a peut-être là quelque chose d’inaugural : entrer dans la société humaine, c’est accepter de manger de l’animal alors qu’il est présenté comme le meilleur ami de l’enfant.
Dans notre psyché, il y a donc un clivage : là c’est notre compagnon, là c’est un animal de boucherie. Ma thèse, c’est qu’on est encore entièrement dans le modèle de Descartes.
DB : Cette complexité relationnelle avec les animaux ne me choque pas. Et me semble même naturelle. Nous autres humains, vivons toujours dans des dimensions multiples et interrelationnelles avec les autres humains et non-humains. Je peux juger ces relations avec le vrai et le faux, le bien et le mal, le beau et le laid… Nous nous renvoyons à des modalités de jugement. Et les faisons cohabiter toutes ensemble. La diversité, c’est la donnée première de ce qui est naturel. Et elle aura toujours plusieurs dimensions. Donc rien d’étonnant à ce que dans la diversité des animaux, on ait des relations très diverses. Ainsi, on peut aimer et manger par exemple.
Qu’est-ce qui différencie l’être humain et l’animal ? Existe-il seulement aujourd’hui encore une frontière entre les deux ?
JPP : Pour penser l’humain, la philosophie a toujours utilisé son rapport à l’animal. Aristote disait : « bien définir, c’est trouver le genre voisin et la différence spécifique ». Quand il affirme que l’homme est un animal politique et qu’il parle, il fait donc partie des animaux, mais est politique et possède le langage. Toute l’histoire de la philosophie n’a cessé de penser ce rapport de l’homme à l’animal.
Depuis 1970, les choses ont changé. Parler de l’animal humain ne consiste plus à chercher la différence anthropologique mais à la faire disparaître. Entre l’animal humain et non-humain, il n’y aurait plus qu’une différence de degré, non de nature. On cherche à insister - via des approches anti-spécistes – sur l’idée d’une domination humaine sur les autres vivants. Si l’humain est un animal parmi les animaux, il n’y a plus de supériorité. Mais penser une différence, est-ce nécessairement penser une hiérarchie ? Un rapport de domination ?
Aussi l’enjeu, ce n’est pas de penser moins à l’humain mais de le penser mieux. L’écologie n’est pas un anti-humanisme. De mon point de vue, la conscience de nos interdépendances nous force à mesurer que nous ne serions pas humains sans nos liens avec les autres êtres vivants. Et donc à mesurer nos singularités.
FB : Je pense que la recherche d’une frontière est aussi vaine qu’oiseuse. D’ailleurs, comment trouver une frontière quand il existe tant de formes animales différentes ? Il existe une multiplicité de différences et ces différences se déplacent.
Tant qu’on considérera les animaux à l’aune de l’humain, l’on persistera à voir l’animal comme un humain moins quelque chose et l’humain comme un animal plus quelque chose. Cette logique n’a aucun sens. Elle en vient à définir « l’animal » (au singulier, comme si tous existaient sur le même mode), par une série de négations : pas d’âme, pas de langage, d’histoire, de société, de conscience... Il faut sortir de ces définitions purement idéologiques, dont l’unique mobile est d’abaisser les animaux afin de les utiliser de la pire façon. Il faut au contraire penser l’originalité de chaque forme de vie. Le travail que je conduis sur la psyché animale met cependant au jour une communauté de destins. Tous les mammifères connaissent par exemple le premier traumatisme de la naissance, le passage d’un milieu aqueux à un milieu aérien. Et les formes d’angoisse que cela implique. Le fait de fuir le danger indique que l’individu craint pour sa vie, qui montre qu’il a le sentiment de la mort. Ces êtres n’ont pas la chance de formuler leurs maux dans les mots pour les mettre à distance ; ils sont psychiquement particulièrement vulnérables. Je précise et développe ces questions dans mon dernier livre. Ce qui oblige moralement, c’est la capacité à souffrir et non l’intelligence.
DB : Je ne suis pas d’accord. Il n’est pas obsolète de distinguer l’homme de l’animal. Mais alors que les modernes le distinguent par une opposition, c’est-à-dire un dualisme, je le distingue par un continuum. C’est-à-dire qu’il existe une distinction sur une continuité. Dans Primauté du Vivant. Essai sur le pensable, le livre que j’ai co-écrit avec Sophie Swaton, nous montrons que nous nous représentons au monde avec le langage, l’accès au symbolique et l’abstraction. Mais sous-jacent à nos représentations, le pensable est une donnée première. Ce pensable est commun à l’animal, au végétal et au minéral, auquel on n’accède jamais.
On y défend une hypothèse moniste (qui affirme l'unité indivisible de l'être, NDLR), c’est-à-dire que l’univers est composé d’une seule substance qui se présente sous deux modalités : la matière et la pensée. Toute notre analyse consiste à dire que ce sont des données premières, qu’il n’y a pas à les engendrer. Conséquence : s’il y a distinction, elle est sur une continuité. L’humain fait partie intégrante du Vivant. C’est la manière dont il articule ce pensable qui est différente de l’animal et du végétal.
Pouvons-nous classer les différentes relations entre l’être humain et l’animal ?
JPP : C’est une question délicate. Pourquoi classe-t-on ? Pour connaître ? Gérer ? Agir ? Il ne faut pas être dupe : ce type d’intelligibilité plaque une vérité sur le monde qui cache toutes les différences.
Ceci dit, nous avons classé les animaux selon les époques. D’abord en fonction de l’ordre établi et des observations (le règle animal, végétal…). Puis selon l’expérimentation et la bio-logique (la génétique par exemple). Et maintenant, selon les savoirs éco-systémiques, c’est-à-dire les relations des êtres vivants entre eux. Car comprendre un vivant, c’est le relier.
Mais il existe aujourd’hui un décalage entre nos savoirs et nos pouvoirs. Nos pouvoirs continuent de faire des mondes construits sur la distanciation et l’analyse, alors que nous savons que nous sommes des êtres de relations. Il s’agit d’une inertie : nos systèmes techniques continuent de se déployer sur le mode d’une culture de l’expérimentation et de l’extraction - dont l’exploitation animale -, alors que nous vivons, nous nous sentons, en relation. Nous sommes dans une transition. Et une partie de notre souffrance provient du fait que nous sommes pris dans une manière de faire monde qui a fait son temps.
DB : Je suis d’accord avec cette notion de liens et de continuité. La classification n’implique pas la dualité. On ne cesse de classifier. C’est la structuration du langage humain qui impose cela. Et c’est toute la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd’hui : comment classer les êtres vivants sur une base continuiste ? Je reprendrais donc plutôt les distinctions de relations de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) : on vit de la nature, avec la nature (on côtoie des êtres humains et non-humains), on vit dans la nature (on peut s’identifier à un écosystème, ce que je suis est aussi la relation au paysage) et on vit en tant que nature (on peut s’identifier à un écosystème, ce qui peut renvoyer à la sacralité, à la spiritualité).
FB : Je rejoins pour ma part les propositions de transformation de la condition animale proposées par Will Kymlicka et Sue Donaldson, philosophes politiques, dans leur livre Zoopolis. Ils distinguent les animaux sauvages, pour lesquels il conviendrait de sanctuariser des espaces à eux, tels que le proposent les philosophes Philippe Descola et Baptiste Morizot.
Pour les animaux domestiques, mais non familiers, ils proposent de construire des relations qui ne se terminent pas dans le sang. Quitte à réduire leur nombre pour que les relations écologiques soient équilibrées. Pour cette catégorie, je rajouterais que je vois mal comment maintenir une justification de la consommation d’animaux sans finir dans le sang.
Enfin, pour les animaux liminaires (qui vivent en liberté dans l'espace urbain à proximité des humains, NDLR), ils proposent une notion de citoyenneté. C’est l’idée d’inclure les intérêts des animaux qui vivent dans les sociétés humaines.
Le mouvement vegan, bien qu’encore marginal en France, se développe. A l’instar du végétarisme et du flexitarisme. Pensez-vous qu’il soit « naturel » et souhaitable de manger des animaux ?
DB : Déjà, je tiens à l’affirmer : penser que manger un animal est immoral, est totalement faux. C’est même anti-écolo ! Le propre du vivant, c’est de se nourrir de lui-même ; c’est la chaîne trophique. Et rien n’est non plus naturel dans une société humaine. Il n’est pas « naturel » de manger de la viande. Cela a été décrété par des choix humains, sur la base d’une alimentation biologiquement omnivore. Cela ne veut pas dire qu’on est obligé de manger de tout.
Et attention à ne pas tomber dans l’extrémisme. Les personnes prônant, par exemple, le véganisme, ont tendance à dénier la nature. Toute leur pensée est basée sur une méconnaissance de ce qu’est un écosystème. Sans animaux de ferme, plus d’engrais naturels, et donc beaucoup d’engrais de synthèse. Idem pour la nourriture des animaux de compagnie : allons-nous rendre les chiens végétariens ? Ou allons-nous leur donner de la viande de synthèse ?
Je vous invite à ce propos à lire Val Plumwood. Elle raconte comment elle s’est faite attaquer par un crocodile en Australie qui l’a emportée vers le fond pour la noyer. Elle s’en est sortie miraculeusement. Et a vécu ça comme une expérience mystique dans laquelle elle a réalisé son appartenance à la chaîne trophique. Depuis, si elle est restée végétarienne, elle est devenue très critique du véganisme. Elle a réalisé qu’elle n’était qu’un élément du monde de la Nature.
Mais il ne s’agit évidemment pas de manger de la viande à tout va ! Peu en quantité et issue d’animaux bien traités.
FB : D’un point de vue philosophique, mon discours est radical. Car nous ne sommes pas ici en train de faire de la politique. Faire de la politique, c’est tenter de concilier des intérêts contradictoires et donc de trouver un compromis. La tâche de la philosophie n’est pas celle-ci. Elle cherche à dégager des principes, à tester leur solidité et à en tirer les conséquences, si l’on peut dire les choses ainsi. A partir du moment où il est entendu que les animaux tiennent à leur vie comme à un bien unique, qu’ils ont des intérêts en propre et que l’humanité peut vivre, et bien évidemment se nourrir aujourd’hui sans tuer, alors les activités de chasse, de boucherie et de pêche doivent être bannies. Cet attachement à la viande est du reste à mes yeux assez grotesque. Faut-il rappeler que l’homme est omnivore, ce qui signifie qu’il peut choisir son alimentation, et que tous les animaux ne pas carnivores ? L’option carnivore est désormais une gourmandise, mais qui fait mal. Beaucoup vous disent que ce n’est pas un problème de tuer les animaux, que ce qui compte est uniquement les conditions de vie. Je ne vois pas pourquoi, en ce cas, cela ne s’appliquerait pas aux êtres humains.
Pourquoi ne sublimons-nous pas notre violence envers les animaux ? Pourquoi les préférons-nous morts plutôt que vivants ?
JPP : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », affirmait le philosophe et gastronome Jean Anthelme Brillat-Savarin. Car philosophiquement, manger n’a rien de naturel. Nous choisissons ce que nous mangeons ou ne mangeons pas. Manger, ce n’est pas simplement ingérer des protéines, c’est prioriser et s’insérer dans un système de valeurs : bon/mauvais, pur/impur, « naturel »/artificiel, cru/cuit… Cela me qualifie ou me disqualifie vis-à-vis des autres humains et des non-humains.
Manger, c’est chercher en dehors de soi ce qui contribue à nous maintenir en vie. Il en résulte forcément une forme de prédation et de violence. Il faut arracher au monde sa part. Mais comment conjugue-t-on cette dimension tragique ? Peut-on s’en passer pour atteindre une pureté dépourvue de tragique ? Personnellement, je m’inquiète de cette idée d’une pureté absolue. Croire que l’on puisse faire l’économie du tragique. Et si l’on souhaite être cohérent jusqu’au bout, pourquoi continuer à ôter la vie des végétaux par exemple ?
Finalement, la question sous-jacente est : quel humain souhaitons-nous être ? Définir notre relation à l’animal est un enjeu d’existence entre emprise et être en prise.
Nous savons aujourd’hui que notre propre survie est directement menacée par l’effondrement de la biodiversité. Quel rapport pourrions-nous instaurer avec les animaux pour reconstruire un équilibre du Vivant ?
FB : Malheureusement, ce que j’entends surtout dans les discussions et les médias, c’est une désolation de cet effondrement pour l’espèce humaine, comme si elle était seule à en pâtir. Aucune mention des oiseaux qui meurent de la canicule ou des poissons étouffés par du plastique, et jamais un mot sur les « animaux de boucherie » entassés et engraissés dans des bâtiments. Comment ne pas constater un profond mépris pour ces animaux de l’ombre ? Tant qu’on dira que les animaux font partie de « notre environnement », tant qu’on ne les considérera pas comme des ayant-droit à une vie bonne sur cette terre, rien ne changera. Nous ne sommes pas du tout sortis de cette vision anthropocentrée du monde.
JPP : De mon côté, je pense que l’un des enjeux est de montrer que toutes les formes du Vivant, dans leur pluralité, nous augmentent en nos interdépendances, répliquant à la pulsion morbide des écocides. Nous sommes sidérés par la dévastation des vivants ; il y a à les considérer pour re-connaître chaque être en sa valeur singulière. Il existe une multiplicité de formes de vie sans lesquelles nous ne saurions être ce que nous sommes - plante au bord du chemin ou araignée du plafond. Nommer chaque être - le considérer - l’introduit finalement au sein de notre substance d’existence.
DB : Surtout, quand vous permettez à la nature de vivre, elle revient en force. Comme on l’a vu lors du premier confinement. L’équilibre entre les différents membres du Vivant pourrait donc se réinstaller tout seul, à la seule condition de ne rien faire. Tel dans le projet de forêt primaire européenne de Francis Hallé (2). De plus, tout indique que nous sommes trop nombreux sur Terre et que l’on reviendra à l’horizon d’un ou deux siècles à des effectifs plus raisonnables. Le réensauvagement sera alors rendu possible. Or, selon moi, nous ne pouvons pas revoir notre rapport à l’animal sans redonner sa place au sauvage. Réapprendre à vivre avec le sauvage, avec cette nature puissante à laquelle nous appartenons.
A lire
Je est un nous, Jean-Philippe Pierron, Ed. Actes Sud, 2021, 20 €.
Primauté du vivant. Essai sur le pensable, Dominique Bourg et Sophie Swaton, Ed. Puf, 2021, 17,99 €.
L’inconscient des animaux. Une lecture freudienne, Florence Burgat, Ed. Seuil, 2023, 23 €.
(1) L'animal-machine est une thèse de la métaphysique largement développée par Descartes, selon laquelle le comportement des animaux est semblable aux mécanismes des machines. Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et rouages, dénués de conscience ou de pensée.
(2) Francis Hallé porte un projet de forêt primaire en Europe de l’Ouest. Celui-ci consiste à « ne rien faire » sur un espace de 70 000 hectares, pour une durée de plusieurs centaines d’années, afin de voir se réinstaurer la vie sauvage.