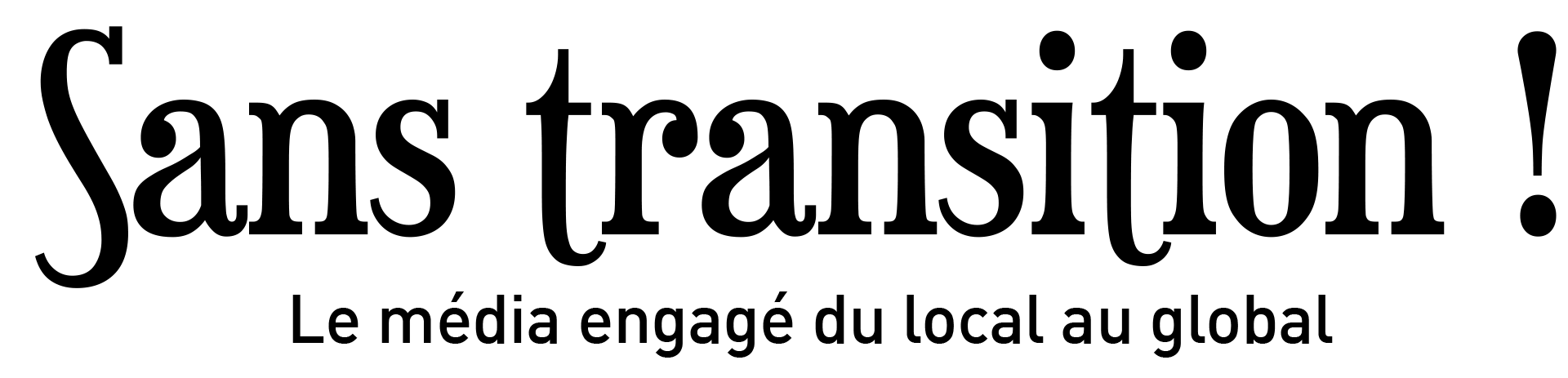Le neuro-psychiatre Boris Cyrulnik a fait connaître en France le concept de résilience (renaître de sa souffrance). Un concept plus que d'actualité en cette période de crise, avec la pandémie de Covid-19. Avant de retrouver le psychiatre sur notre site pour une conversation avec Sans transition! le 15 mai prochain, nous republions cet entretien réalisé il y a trois ans, autour de la notion de « bien-être ».
Burn out, suicide, souffrance… Pourquoi de plus en plus de gens souffrent tant au travail ?
L’homme souffre d’abord psychologiquement au travail, bien que la souffrance physique se manifeste toujours dans certains métiers, notamment par la sédentarité que provoquent les machines. Par manque d’activité physique notamment dans leur travail, de nombreuses personnes sont touchées par le diabète, les maladies cardio-vasculaires la malbouffe et autres troubles de la sédentarisation. Avec Internet : d’aucuns peuvent même aller jusqu’à passer entièrement leur vie du fauteuil au lit… A contrario, quand j’étais gamin, le travail se caractérisait d’abord par une souffrance physique. Les paysans se levaient à l’aube, mangeaient à peine à midi. J’ai le souvenir de mon père croquant un quignon de pain au déjeuner. Les paysans et mineurs travaillaient à l’époque jusqu’à 15h par jour. Le labeur prenait alors la forme d’une souffrance avant tout physique. Désormais, la souffrance est provoquée par nos progrès technologiques. Nous faisons passer les machines avant les hommes. Certes, l’homme a fait de gros progrès technologiques, mais au prix d’une altération majeure des relations humaines au quotidien. Nous pouvons dire que ces relations humaines sont pour l’heure « déritualisées ».
Qu’appelez-vous la « déritualisation » sociale et en quoi ce phénomène nuit-il aux humains dans leur quotidien ?
Au travail, on se dit de moins en moins « bonjour », voire uniquement par l’intermédiaire d’écrans. Parallèlement, les entraides tendent à disparaître au quotidien. Lorsque j’étais étudiant en médecine, les jeunes étaient plus solidaires. Maintenant les étudiants cachent leurs cours car le copain est devenu un concurrent… C’est le sprint social, la compétition au détriment de la coopération, qui désolidarise les familles. Prenons l’exemple des agriculteurs, un métier dans lequel la solidarité a toujours eu une grande place. Aujourd’hui, les nouveaux paysans sont devenus des entrepreneurs de haut vol, des chimistes, des mécaniciens. Mais ils sont de plus en plus seuls sur leur tracteur. Le lien social disparaît. C’est d’ailleurs bien souvent pour cela qu’ils font face à d’importants risques psychosociaux, dont les suicides…
En quoi ces générations passées que vous évoquez tissaient-elles davantage de lien social ?
Jadis, malgré l’épuisement physique, il y avait bien souvent davantage de convivialité (à l’instar des fêtes de village), associée à une véritable culture populaire. Des cars ramassaient les ouvriers d’Aubervilliers pour faire la fête, voir des opéras, du sport… J’habite à la Seyne-sur-Mer dans le Var et tous les week-ends les italiens et les polonais jouaient de la musique ensemble. C’était un délice relationnel malgré l’épuisement physique. Un vecteur de bien-être. Tout cela a disparu. Lors des fêtes d’entreprise, les gens n’éprouvent plus cette authenticité. Ces soirées sont elles-mêmes de grands spectacles commerciaux. Et la fête de la musique devient également un raout commercial, un boucan. Il faut du temps, pour transformer les rituels…
Comment en est-on arrivé à cette perte de repères et de liens ?
Pour comprendre, nous devons remonter le temps jusqu’à nos origines. Avec Homo Sapiens, notre espérance de vie était brève. Jusqu’au XIXe siècle et la révolution industrielle, l’espérance de vie des femmes avoisinait 36 ans. Au Congo, c’est 40 ans actuellement. Il y avait jadis la famine, le froid, et déjà la pollution des grandes villes avec la révolution industrielle. Les risques écologiques étaient déjà grands. Jusqu’en 1950, il fallait triompher de la nature, c’était notre ennemi. Triompher du tétanos, de la polio… Pour vivre mieux. Depuis 1960, la culture est devenue notre ennemie car la culture a modifié la nature, au risque de nous faire perdre la tête. C’est nous qui intoxiquons l’eau, l’air… c’est nous les humains qui avons dégradé l’environnement. Nous influons même notre climat planétaire : la sécheresse est en train de se développer à grande vitesse. Or sans eau notre espérance de vie est courte. Face à cet environnement chamboulé, beaucoup de repères ont été perdus. Résultat : la migration devient urgente à cause des catastrophes humaines et politiques. 60 millions de migrants arpentent la planète. On en attend 200 millions les prochaines années. Jusqu’à maintenant, les migrants participaient à la richesse d’un pays d’accueil or si 200 millions de gens sont obligés de partir de chez eux, il va y avoir un énorme bouleversement culturel. Je fais le pari que ça va être l’enjeu majeur des années à venir…
Dans ce contexte « déritualisé », peut-on vraiment envisager un état de bien-être collectif durable ?
Le bien-être est le résultat d’un rythme, d’une alternance entre la fatigue physique et le repos physique. Entre l’effort intellectuel et la décontraction intellectuelle. Si l’on perd ce rythme, alors on arrive à des situations difficiles, où les risques psychosociaux (RPS) deviennent prégnants. Où l’humain décroche. Ainsi, notre société invite au décrochage. Paradoxalement, alors que nous n’avons jamais été autant en bonne santé, on observe pourtant beaucoup de mal-être au quotidien. Pour envisager un bien-être collectif, nous devons remettre du sens dans le travail, dans nos vies. Pour retrouver le goût de l’effort et l’intensité qui précède le bien-être. Aujourd’hui on accumule, on consomme dans l’urgence. Cette consommation dans l’urgence n’a malheureusement plus aucun sens. Seule la drogue permet de jouir sans y mettre du sens.
Pourquoi certains ont-ils perdu le sens de la vie ?
Pour parler de sens, parlons de signification et de direction. Jusqu’ici, le rêve était de triompher de la nature, désormais seule une minorité rêve d’aventure sociale. Une majorité n’a plus accès au rêve. Pour nos grands-parents, ce sens leur était imposé. À présent, c’est à nous de le recréer. Or on ne peut créer du sens que par la réflexion. Mais tout le monde n’en est pas capable, alors que tout le monde était capable de participer au travail à la mine… On retrouve cette minorité clivée, qui court le monde. Et une majorité de largués pour lesquels la vie n’a plus aucun sens. Ces derniers n’arrivent pas à créer le sens nécessaire.
Sans transition ! convie Boris Cyrulnik pour une conversation citoyenne exceptionnelle ! Nous lançons avec lui un nouveau format en ligne : Le Web sonne.
> Rendez-vous en ligne le vendredi 15 mai à 17h30 !