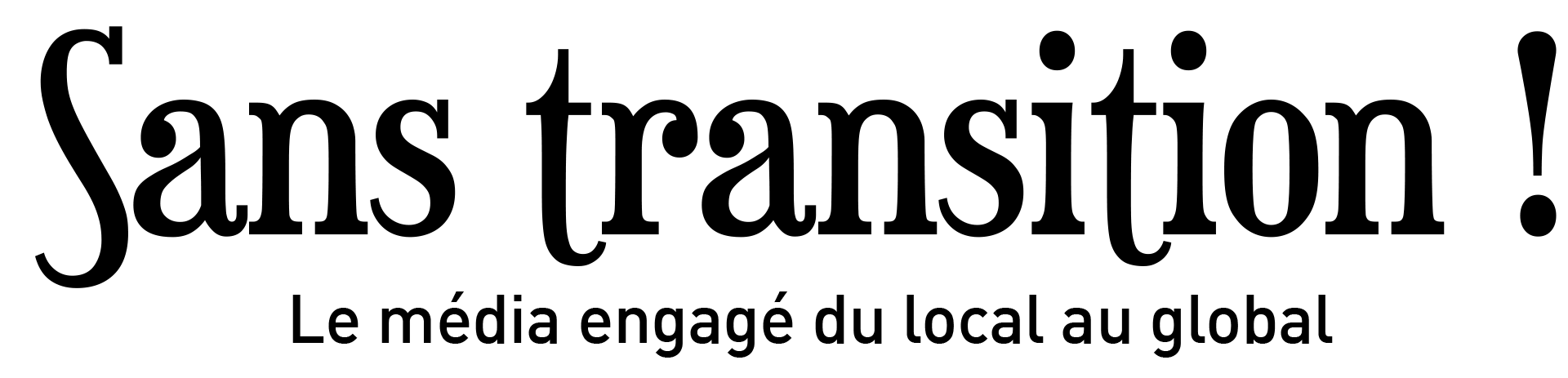Les consommateurs désirent une alimentation sans pesticides. Et même la FNSEA commence à changer son fusil d’épaule en promettant de mettre en œuvre des « solutions » pour diminuer les doses de produits phytosanitaires. Mais l’agriculture conventionnelle peut-elle vraiment rompre sa dépendance à la chimie ?
Par François Delotte
PRODUITS PHYTO : PAR ICI LA SORTIE !
Nouvelles technologies ou agroécologie. Plusieurs pistes sont aujourd’hui débattues pour sortir des pesticides.

Pour Cécile Claveirole, référente agriculture de France Nature Environnement, une moindre utilisation de pesticides passe par la restauration des haies et un retour à des cultures diversifiées. Ici, un paysage de bocage près de Chinon (37). © Pixabay
Diminuer de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires d’ici 2025. C’est la proposition faite par la FNSEA dans son « contrat de solutions » présenté à l’occasion du dernier Salon de l’agriculture, fin février 2018. Le premier syndicat agricole français serait-il enfin conscient des effets délétères de l’agrochimie sur l’environnement et la santé ? Pas si sûr…« Nous pensons que les peurs sont exagérées concernant l’usage de ces produits. Le consommateur estime que ces peurs sont justifiées. Or, nous devons être en phase avec la demande », concède Éric Thirouin, secrétaire général adjoint de la commission Environnement de la FNSEA.Cependant, « Le zéro phyto n’est pas atteignable », annonce d’emblée Éric Thirouin avant de tempérer : « Mais on peut s’en approcher ».Àquel horizon ?«Je refuse de répondre à cette question. Ce qui m’intéresse, c’est surtout de progresser dans les filières où il y a encore peu d’alternatives », indique ce producteur d’oléagineux dans le Loiret.
Parmi les « 292 solutions » listées par Éric Thirouin, plusieurs concernent les nouvelles technologies. Le syndicat mise notamment sur le développement de l’automatisation. La diminution de l’utilisation de pesticides passerait-elle par une agriculture « high-tech » ?
VERS UNE TECHNO AGRICULTURE ?
La société toulousaine Naïo Technologies y croit.Elle a mis au point des robots désherbeurs. « Ils fonctionnent avec un outil de binage qui passe à 3 cm de profondeur dans le sol et détruit les mauvaises herbes », explique Julien Laffont, chargé du développement marketing de Naïo.« Oz » (pour les petites exploitations) et « Dino » (pour les surfaces supérieures à 10 hectares) s’adressent au maraîchage et à la viticulture.Ils sont entièrement électriques. Ils se repèrent dans les champs via un système de guidage GPS. Selon l’entreprise, les robots éliminent jusqu’à 80 % les végétaux indésirables. Leur prix ?« Entre 20 et 25 000 euros pour Oz et entre 80 et 100 000 euros pour Dino », annonce Julien Laffont.Un tarif qui, pour le représentant de Naïo, ne dissuade pas les acheteurs.«Depuis 2014, nous avons doublé notre chiffre d’affaires tous les ans.La demande commence aussi à se développer en Europe de l’Ouest et nous cherchons à nous implanter aux États-Unis et au Japon », assure-t-il.
D’autres, comme le Rennais Jean-Pierre Barre et sa société Oeliatec, misent sur l’eau bouillante.Après avoir vendu des pesticides pendant vingt ans, l’entrepreneur a changé son fusil d’épaule.« Mais je n’ai pas inventé l’eau chaude, j’applique une méthode qu’utilisaient mes grands-parents pour désherber », plaisante-t-il.Le liquide est chauffé à 120 °C puis est pulvérisé sur les « mauvaises herbes ». Après avoir proposé sa technologie aux collectivités, Oeliatec s’adresse désormais aux agriculteurs.Ses machines, fixées à l’arrière d’un tracteur coûtent entre 15 000 et 100 000 euros. « Le marché agricole se développe très bien. Les agriculteurs peuvent acheter nos produits seuls ou via des groupements et des coopératives », détaille Jean-Pierre Barre, dont la société revendique un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2017.

La société rennaise Oeliatec propose des machines qui neutralisent les « mauvaises herbes » avec de l’eau portée à 120 °C. © Oeliatec
Le marché de ces nouvelles machines agricoles est en pleine expansion.Cependant, l’achat de ces engins coûteux risquent d’augmenter les taux d’endettement de professionnels dont beaucoup sont déjà pris à la gorge. Mais, pour l’heure, il ne permet pas de répondre aux besoins de tous les secteurs. Et il n’existe pas encore de solutions similaires véritablement adaptées aux grandes cultures céréalières et oléagineuses. Par ailleurs, ces technologies ne permettent pas non plus de répondre à tous les enjeux qu’impose la diminution d’utilisation des produits phyto.Notamment pour ce qui concerne la lutte contre les insectes ravageurs ou autres maladies des cultures.
Dans ce domaine, la FNSEA parie sur le développement du « biocontrôle », méthodes naturelles destinées à protéger les cultures.Ainsi, Éric Thirouin assure utiliser depuis « quinze ans des trichogrammes », une petite mouche, pour lutter contre la pyrale du maïs.Les larves de trichogramme se développent dans les œufs du parasite et empêchent leur développement.La méthode semble efficace, puisque Éric Thirouin dit ne plus avoir recours aux insecticides.Ces procédés sont pratiqués depuis longtemps dans l’agriculture biologique, aussi bien sous la forme de macro-organismes (lâchers des coccinelles qui dévorent les pucerons) ou de micro-organismes (virus ou champignons qui s’attaquent aux parasites). Certaines entreprises vont encore plus loin dans la recherche de solutions de biocontrôle. C’est par exemple le cas de la société bretonne Goëmar qui a conçu un produit à base d’algues pour stimuler le système de protection naturel des plantes et les aider à mieux résister aux agressions (champignons, maladies…).
HORS-SOL ZÉRO-PHYTO
Haut niveau de technicité et biocontrôle :c’est ce sur quoi parient les Paysans de Rougeline pour remplacer les intrants chimiques. Cette SAS réunit des producteurs en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence.Elle met en avant ses productions « zéro pesticide ». Et pour cela, développe la culture hors-sol sous serre. « Avec les nouvelles technologies, nous arrivons à produire avec un impact quasi-nul sur l’environnement. Les modèles intensifs sont inévitables si l’on veut arriver à nourrir une population qui augmente tout en faisant face à l’étalement urbain », défend Vincent Clément, producteur de tomates cerise et cocktail à Arles (13), avec son frère Davy, et membre des Paysans de Rougeline.

À Arles, Davy et Vincent Clément visent le zéro phyto en cultivant des tomates cerise et cocktail dans ce qu’ils appellent des . éco-serres. © Rougeline
Dans de vastes serres réparties sur 5 hectares, poussent des cultures suspendues.Les racines ne se développent pas en pleine terre, mais sont plongées dans un substrat organique ou de la sciure de coco. Elles sont alimentées en nutriments avec de l’eau qui circule en circuit fermé.Le liquide est recyclé sur place.Les serres sont chauffées grâce à une chaudière bois performante. Ce qui garantit 15 % d’économie d’énergie par rapport à une serre conventionnelle, affirment les exploitants.
L’air extérieur est aussi filtré. Il passe par de fines mailles qui empêchent les insectes de rentrer dans les serres. Le climat est géré « au dixième de degré près.Ce qui permet d’éviter les pourritures fongiques (champignons – NDLR) et des maladies comme le mildiou.Par prévention, nous introduisons tout de même des prédateurs des éventuels ravageurs. Nous lâchons dans les serres des macrolophus, une punaise qui mesure 2-3 cm»1, détaille Vincent Clément.
Nous serions donc face à des « éco-serres » qui produisent « 2000 tonnes de tomates par an » affirme Vincent Clément. Mais le système a ses limites. Il est plus aisé d’atteindre ces performances avec le climat ensoleillé des Bouches-du-Rhône qu’au nord de la Loire. Et si le dispositif est efficace pour produire des tomates cerise et éventuellement des salades et herbes aromatiques, il n’est pas applicable pour la production des céréales. Un autre aspect pose question : la provenance des engrais utilisés pour nourrir les plantes, comme le sulfate et le potassium venant d’Israël.Vincent Clément confie ne pas avoir d’informations sur ces produits. « Le souci, en hors-sol, c’est que certains engrais minéraux ne sont peut-être pas produits de façon durable. Les minéraux viennent souvent d’exploitations minières. Or, quand une ressource provient de la terre, un jour elle vient à manquer », commente Pierre-Frédérique Bouvet, ingénieur agronome et cofondateur de Cueillette Urbaine, société qui crée des potagers d’entreprise selon les principes de la permaculture.
RENOUER AVEC LA POLYCULTURE
Pour Cécile Claveirole, pilote du projet « agriculture » de France Nature Environnement et membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, « avant de vouloir produire à grande échelle en hors-sol, il faudrait réduire notre consommation d’espace et préserver les terres agricoles ». Pour elle, les propositions de la FNSEA axées sur les nouvelles technologies pour réduire l’utilisation de pesticides ne sont pas les plus pertinentes. « La démarche amorcée par la FNSEA avec ce contrat de solutions va globalement dans le bon sens. Mais des choses me gênent. Il faut que les agriculteurs diminuent leurs charges et leurs intrants, qu’ils deviennent plus autonomes. Or ils le seront moins s’ils se jettent dans la gueule des machinistes », argumente cette ingénieure agronome. Pour Cécile Claveirole, rendre autonome le paysan, c’est utiliser les pratiques de l’agroécologie : replanter des arbres et des haies pour favoriser les insectes « auxiliaires » qui s’attaquent aux parasites, mais aussi promouvoir la polyculture et les rotations qui contribuent à la qualité des sols.
« Les rendements sont parfois plus importants en associant des plantes plutôt qu’en utilisant des pesticides », lance Pierre-Frédérique Bouvet. « Cultiver ensemble des céréales et des légumineuses (trèfle, luzerne…) qui enrichissent les sols permet une augmentation de rendement de 10 à 60 % par rapport à une monoculture. Associer tomates et laitues, c’est jusqu’à 61 % de production supplémentaire », poursuit-il. Mais cela nécessite de changer en profondeur le modèle agricole dominant. « Et pas forcément des investissements supplémentaires. Il faut orienter différemment les financements. Au lieu de disposer de conseillers agricoles qui expliquent aux professionnels comment utiliser les pesticides, les chambres d’agriculture pourraient engager des formateurs en agroécologie », évoque Cécile Claveirole.
Un avis partagé par la Confédération Paysanne qui, pour remplacer certains traitements chimiques, plaide pour l’utilisation des « Préparations Naturelles Peu Préoccupantes » (PNPP). Ces PNPP sont des substances naturelles stimulantes (purin d’orties…) ou protectrices pour les plantes (tisanes…).« Un décret de 2016 liste 148 plantes que l’on peut utiliser pour les cultures. Mais nous demandons que 800 végétaux et préparations supplémentaires puissent être évalués par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement) », revendique Jean Sabench, représentant de la « Conf ».

La Confédération paysanne promeut l’utilisation de « Préparations Naturelles Peu Préoccupantes » pour remplacer les pesticides. Les orties, sous forme de purin, constituent par exemple un excellent amendement. © Pixabay
MÊMES RENDEMENTS SANS INSECTICIDES
Mais peut-on seulement nourrir les populations sans insecticides ? « Oui », répond Jean-Marc Bonmatin, chimiste et toxicologue au CNRS. Ce dernier a contribué à la rédaction d’un article publié en février 2018 dans le journal scientifiqueEnvironnemental Science and Pollution Research portant sur l’efficacité des néonicotinoïdes. « Nous nous sommes appuyés sur plus de 200 études.Nous nous sommes alors rendus compte que les rendements sont quasiment identiques, que l’on utilise ou non ces insecticides », explique le chercheur. Il préconise donc de mettre fin aux traitements dits « préventifs ». « C’est absurde de traiter 100 % des parcelles puisque le pourcentage des cultures concernées par les attaques de ravageurs ne concerne en moyenne que 4 %, pour le maïs par exemple », assure-t-il. Les scientifiques notent aussi que les ravageurs développent rapidement des résistances aux pesticides. Et que ces substances sont très nocives pour « les organismes utiles du sol et pour les insectes bénéfiques à l’agriculture ».

Un nouveau label, différent du bio, vient de faire son apparition dans les rayons fruits et légumes. Baptisé « Zéro résidu de pesticides », il garantit que les produits ne présentent pas plus de 0,01 mg de pesticide au kilo. Le concept est différent du bio. Les fruits et légumes ont le droit de pousser sur des substrats nutritifs, ce qui est interdit en agriculture bio. Une forme de bio « light » ?
L’article recense aussi des alternatives à l’utilisation de la chimie. Notamment un système d’« assurance mutuelle » utilisé par des agriculteurs du Frioul et de la Vénétie, en Italie. «53 000 hectares ne sont plus traités aux insecticides. Les agriculteurs adhèrent à une assurance tous risques qui rembourse aussi les dommages en cas d’attaque de ravageurs. Elle ne leur coûte que 3,5 euros par hectare contre environ 40 euros/hectare pour un traitement insecticide », précise Jean-Marc Bonmatin.
Cet ensemble d’éléments montre que la sortie des pesticides est possible. Mais Rome ne s’est pas faite en un jour… L’association Solagro propose un plan chiffré et progressif d’abandon des produits phytosanitaires, dans le cadre de son scénario « Afterres 2050 ». « Nous estimons qu’il est possible d’atteindre une diminution de 75 % d’utilisation de ces substances en 2050 »2, développe Philippe Pointereau du Pôle environnement de Solagro. Dans ce modèle, 50 % des exploitations agricoles seraient bio. Les projections d’Afterres se basent sur le développement de l’agroécologie et du biocontrôle. Mais aussi sur la nécessité « de réduirede 50 % notre consommation totale en protéines », et donc de viande, dit le rapport Afterres 2050. Ce qui permettrait de « maximiser les prairies naturelles et de diminuer le recours à l’ensilage composé de soja et de céréales venant souvent d’Amérique et traités au glyphosate », précise l’agronome. Il poursuit : « Nous avons aussi réalisé un scénario zéro-phyto en 2050. Il est techniquement tenable. Après, tout est question de politique et de moyens. Les leviers sont nombreux : taxe sur les phytosanitaires, taxe pollueur-payeur, conseil, formation, labellisation… ». On y va ?
Plus d’infos :
www.fnsea.fr/media/2711188/2-2017-11-13-Contrat-de-solutionsVF.pdf
www.fne.asso.fr
www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=6396
www.afterres2050.solagro.org
1. Cette petite punaise est un prédateur de l’aleurode, petit insecte qui s’attaque à des espèces végétales cultivées sous serres.
2. Pour comparaison, le plan gouvernemental Éco-phyto II prévoit une diminution de l’utilisation des pesticides de 50 % d’ici 2025. C’est aussi ce que préconise la FNSEA dans son « contrat de solutions » .
OGM « insecticides » : une non-solution
Le maïs OGM "Bt" sécrète une protéine toxique pour les larves de la pyrale, "ravageur" qui s’attaque notamment au maïs. © EntomartUne plante qui produit son propre insecticide.C’est la propriété du maïs dit « Bt », mis au point et commercialisé par Monsanto.Cette variété a été génétiquement modifiée afin qu’elle puisse elle-même générer une protéine toxique pour des insectes « nuisibles », notamment pour la pyrale.Des colza, soja ou encore coton « Bt » ont aussi été mis au point.Le procédé semble pour l’heure globalement efficace. Mais certaines résistances chez la pyrale ont déjà pu être observées, notamment en Amérique du Nord. L’utilisation de ce type d’OGM pose de nombreuses questions. D’abord parce que la toxine peut porter atteinte aux insectes pollinisateurs. « Pour les abeilles, une toxine Bt reste un insecticide »,rappelle ainsi Jean-Marc Bonmatin, toxicologue au CNRS. Le risque sanitaire lié à la présence de la toxine Bt dans des produits à base de maïs destinés à l’alimentation animale et humaine est sujet à débat.En 2011, une étude québécoise a mis en évidence la présence de toxines Bt dans le sang de femmes enceintes et de leur fœtus*.
* Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada, Aziz Aris et Samuel Leblanc, in Reproductive Toxicology,2011.
DELPHINE BATHO NE CAUTIONNE PAS LE RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LES PESTICIDES
Delphine Batho, députée PS des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l’Environnement, a quitté la vice-présidence de la mission d’information parlementaire sur les pesticides, le 29 mars dernier. Dans ce cadre, les élus travaillaient sur la rédaction de propositions adressées au gouvernement pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. « Je ne peux pas cautionner un certain nombre de formules qui sont dans les titres de ce rapport et qui relativisent l’impact des pesticides sur la santé ou sur la biodiversité dont l’évaluation resterait "délicate", "complexe", [...] le "lien de causalité qui ne serait pas établi", etc... Ces poncifs participent d’une fabrique du doute », a-t-elle justifiée en commission parlementaire, le 4 avril dernier, avant la remise du rapport, le lendemain.
Drôme : la Biovallée trace son sillon
Par FD

DR
Écoconstruction, protection de la biodiversité, mais aussi agriculture durable… La vallée de la Drôme (26) est très avancée en matière de transition. En 2009, quatre communautés de communes du cœur du département s’associent (communautés du Crestois, du Val de Drôme, de Saillans et du Diois) et sont désignées « Grand projet Rhône-Alpes » par l’ex-région Rhône-Alpes. 10 millions d’euros alloués sur six ans ont pour objectif de créer un territoire « laboratoire dans le domaine des éco-activités ». Le projet prend le nom de « Biovallée ». Les agriculteurs du territoire sont invités à y participer.
37 % de surfaces agricoles bio
« La région a subventionné les démarches de certification bio. Mais a aussi aidé les entreprises qui s’investissent dans la transformation des produits bio. Une pépinière d’agriculteurs bio a été mise en place », indique Didier Jouve, vice-président de l’association qui coordonne Biovallée. Une politique qui permet aujourd’hui d’atteindre le taux de 37 % de surfaces agricoles bio dans le territoire (contre 15 % en 2008, 29 % en 2012et 5,7 % au niveau national).Mais les agriculteurs conventionnels ne sont pas laissés de côté. « Nous les aidons à accéder à des subventions européennes pour acheter du matériel de désherbage mécanique. Le projet doit être inclusif », commente Didier Jouve. « 85 % des aides sont destinées au conventionnel », complète Serge Krier, viticulteur bio, maire de la commune de Suze et vice-président à l’agriculture à la Communauté de communes du Val de Drôme. Le Grand projet Rhône-Alpes a pris fin. Mais l’association continue sur sa lancée. « C’est une image de marque. Nous sommes devenus une référence au niveau national, voire européen », défend Serge Krier. Objectif : atteindre les 50 % de surfaces agricoles en bio en 2050.
Plus d’infos : www.biovallee.fr
INTERVIEW
François Veillerette, Générations Futures : « Taxer l’agriculture polluante pour rendre accessible les produits sains »
L’association Générations Futures a publié en février 2018 un État des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France. Entretien avec son directeur, François Veillerette, pour qui l’alimentation sans pesticides devrait être démocratisée.
Propos recueillis par FD

© Nadine Lauverjat
Comment avez-vous procédé pour réaliser votre État des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France »?
Nous avons utilisé des données collectées par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) dans le cadre de plans de surveillance des résidus de pesticides qu’elle a effectués de 2012 à 2016. Pour que les résultats soient significatifs, nous n’avons sélectionné que les denrées qui figuraient dans au moins quatre des cinq derniers plans de surveillance.19 fruits et 33 légumes ont été retenus. Nous avons indiqué les résidus de pesticides quantifiés et les limites maximales de résidus (LMR), soit les niveaux supérieurs de concentration de résidus autorisés dans – ou sur – les produits alimentaires.
Quels sont les produits les plus concernés par ces résidus ?
Pour les fruits, ce sont les raisins (89 % des échantillons contiennent des résidus), les agrumes (qui sont trempées dans des fongicides avant transport), ou les fraises qui sont les plus exposés. Du côté des légumes, nous avons été surpris de trouver le céleri branche, par exemple, comme étant l’un des produits les plus concernés par les résidus. Les herbes fraîches, les endives et les salades comprennent aussi des traces importantes.
Peut-on produire du « zéro pesticide » accessible à tous ?
Le modèle agricole dominant est dépendant aux pesticides. Il ne permet d’ailleurs plus aujourd’hui à tous les agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Par ailleurs, nous constatons que le bio est lui plus rémunérateur. Mais il est plus cher pour les consommateurs, c’est vrai. Or les personnes qui sont les premières concernées par les impacts négatifs des produits phytos sur la santé (maladies chroniques, obésité…) sont les plus modestes. Les produits de l’agriculture intensive sont peu chers à l’achat. Mais ils coûtent très cher en dépense de santé, en traitement des eaux… C’est au final le citoyen qui paye par l’intermédiaire de ses impôts. On pourrait imaginer un système de taxation de cette agriculture polluante pour aider les moins favorisés à acheter des produits sains.
Télécharger l’État des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France sur : www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides/